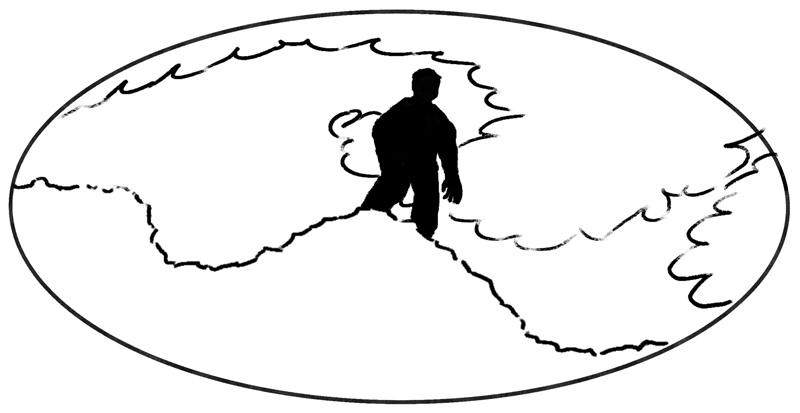Toutes les images méritent d’être regardées
Shireen Seno



Comment vous êtes-vous intéressée à l’art et quand avez-vous su que vous vouliez faire des films ?
J’ai grandi dans une famille philippine au Japon. Mes parents ont migré au début des années 80, je suis née là-bas. Ma mère était professeure dans une école internationale, très tôt j’étais censée représenter les philippines dans cette école. Ça m’intimidait beaucoup d’autant plus que je me sentais très loin des Philippines. J’ai été exposée à l’art à travers mes sœurs, la plus grande était céramiste et la deuxième était peintre. Je ne pensais pas avoir de sensibilité artistique, j’étais une geek, je faisais des sites internet au lycée. J’ai fini par aller étudier à l’Université de Toronto où j’étais très ouverte à de nouvelles expériences. J’étais heureuse d’être loin de ma famille et du Japon. C’est à Toronto que j’ai eu une révélation en quelques sortes. Je voulais étudier l’architecture et par chance, j’ai aussi pris un cours sur le cinéma japonais qui a été déterminant pour moi. C’était un cours qui explorait le développement parallèle du cinéma et du capitalisme au Japon. Ça m’a ouvert les yeux sur le pouvoir du cinéma et tant d’autres choses que je ne comprenais pas étant enfant et qui soudain prenaient tout leur sens. Je suis tombée amoureuse des films mais je ne pensais pas en faire moi-même. J’en regardais beaucoup, je lisais, je faisais du commissariat et de la programmation... À Toronto, il y a tellement de choses à voir, tous les jours ! C’est une ville de cinéma. Je suis aussi tombée sur une copie VHS d’un film Philippin de 1979, Perfumed Nightmare de Kidlat Tahimik. C’est un journal filmé dans lequel il joue. C’est un cinéaste qui a étudié l’économie aux Etats- Unis puis s’est retrouvé en Europe à la fin des années 70 et a décidé de devenir artiste. Il a tout quitté pour changer de vie. Quand j’ai vu ce film, très brut et très drôle, cela m’a donné envie de voir plus de films philippins. C’est aussi à cette époque qu’on a commencé à voir apparaître les films de Lav Diaz. Le festival de Toronto a montré son film Evolution of a Filipino Family (2004) quand j’y étais. Je suis ensuite retournée au Japon, j’avais la sensation qu’il fallait que je revienne là-bas pour clore un chapitre de ma vie. J’ai la sensation d’avoir grandi dans une bulle, dans une école internationale, sans être réellement immergée dans la culture du pays. Quand je suis revenue, j’ai commencé à faire de la photographie et j’ai eu la sensation d’avoir trouvé un outil qui me convenait. Je voulais aussi programmer des films et montrer des films philippins au Japon pour essayer de sortir de l’image mainstream qu’on peut avoir des Philippines à travers la télévision et des reportages misérabilistes et racoleurs. J’ai décidé d’aller à Manille pour voir ce qui se faisait là-bas, les mouvements punks, etc. J’ai ressenti une vraie connexion et j’ai fini par y emménager et y faire des films.
Quels sont les points de départ de...
Nervous Translation ?
Je crois qu’il y a un fil conducteur dans mon travail, j’essaie toujours de comprendre ce que cela signifie de grandir, c’est un peu le dénominateur commun à tous mes films. J’ai la sensation qu’on m’a imposé un chemin étant enfant, mes parents avaient tout prévu, mon métier, l’école où j’étudierai... Ils pensaient que j’allais vivre aux Etats- Unis et gagner suffisamment d’argent pour les aider. Quand je fais des films, j’essaie de travailler sur mes souvenirs et de créer quelque chose de nouveau à partir de cette période de ma vie. L’histoire de Nervous Translation vient d’un rêve que j’ai fait dans lequel je devais chercher un stylo pour « traductions nerveuses ». J’étais très intriguée par cette formule et j’ai eu envie d’explorer cette piste. C’est devenu un mélange de mes souvenirs d’enfance dans les années 80 et de ce rêve. Après avoir fait ce deuxième long-métrage, j’avais envie de revenir à une expérience plus solitaire. Faire un film de cinéma, c’est un travail de groupe et je suis très introvertie donc j’avais besoin de faire des films dans mon coin pour quelques temps.
A child dies, a child plays, a woman is born, a woman dies, a bird arrives, a bird flies off ?
A child dies… est né de ma peur des oiseaux et de la fascination de ma fille pour ces mêmes animaux. C’est un projet encore en cours. À cause de la pandémie, j’ai demandé à des amis amateurs d’oiseaux s’ils pouvaient partager avec moi leurs images. Je les ai donc ensuite associées à des vidéos tournées chez moi en famille, de ma fille qui grandit et de ma mère qui vieillit. C’est aussi une façon pour moi de préparer un long-métrage qui s’intitulera The Wild Duck. C’est un film qui s’inspire de l’histoire de mon père aux États-Unis. Le projet s’intéresse aux migrations dans toutes leurs formes et à la façon dont les oiseaux, comme les humains, trouvent le moyen de survivre dans n’importe quel environnement. J’ambitionne de filmer la plus grande variété d’oiseaux possible capturée à travers plusieurs générations de techniques d’enregistrement vidéo.
To Pick a Flower ?
J’ai fait To Pick a Flower pendant la pandémie. Il fallait que je fasse un film avec ce que j’avais sous la main. J’ai trouvé énormément d’archives de l’époque coloniale aux Philippines sur les sites d’universités américaines. J’ai exploité ce fond en cherchant une porte d’entrée pour un éventuel film. J’ai toujours vu la nature comme un havre de paix. J’ai fini par tomber sur ces photos issues de l’industrie du bois. Ma mère me disait toujours que la table de la salle à manger était aussi vieille que moi. J’ai longtemps pensé que c’était une façon étrange de parler d’un meuble et j’ai toujours voulu mettre cela dans un film. C’est cette anecdote qui m’a amenée à m’intéresser aux débuts de la photographie aux Philippines en lien avec l’évolution du capitalisme et de l’industrie du bois.
Il y a une grande liberté dans votre travail. Vous ne vous embarrassez pas d’une pression du résultat, en montrant par exemple des versions encore inachevées de A child dies… Dans To Pick a Flower, la voix-off n’est pas parfaite. Il y a quelque chose de très détaché dans votre façon d’aborder la création, comme une désinvolture, comme un geste totalement affranchi des injonctions de formes. Toutes les images méritent d’être regardées, peu importe la technique utilisée ou le niveau d’avancement des projets. C’est à la fois très ludique et très excitant.
Je me sens très libre. J’ai beaucoup de chance d’être soutenue comme je le suis, par le système, des institutions, et mon conjoint, John Torres, qui est aussi artiste et cinéaste. Il m’a beaucoup guidé dans mon travail, pas tant en termes de création, il sait que j’ai ma propre identité, mais plutôt en termes de méthode de travail. Le plus important pour lui, c’est le processus, pas le résultat. C’est une vision qui a déteint sur moi. On se soutient mutuellement. Ce n’est pas simple de vivre de son travail quand on est artiste et maintenant qu’on a deux enfants on lutte pour continuer à faire des films mais on intègre cela dans nos projets donc c’est une bonne chose aussi.
Et en même temps, bien que vous n’ayez pas peur de dévoiler vos secrets et de montrer un film encore en cours de fabrication, la notion de mystère est essentielle dans votre travail. Vous laissez des zones d’ombres et construisez vos récits autant sur ce qui est présent à l’écran que sur le manque et l’absence. Pouvez-vous nous parler de votre façon d’aborder la narration dans vos films de cinéma en comparaison avec votre travail vidéo ? Nervous Translation est narratif sans l’être complètement.
J’ai mis très longtemps à écrire ce film. L’écriture n’est pas une chose simple pour moi. Je n’ai jamais étudié la mise en scène ou l’écriture de scénario. C’est un processus très instinctif pour moi. Je suis d’accord, il y a beaucoup de mystère dans mon travail. Ça vient peut-être de la façon dont j’ai grandi, un peu ici et là, entre plusieurs pays, plusieurs cultures. Essayer de comprendre qui je suis n’a pas été simple, il y avait plus de questions que de réponses. C’est ce qui motive Nervous Translation d’une certaine façon. Je suis partie de l’idée du stylo et j’ai associé à cela mes souvenirs en y apportant de la fiction et en imaginant mon enfance aux Philippines. Ce personnage s’inspire de moi mais j’avais aussi à cœur qu’elle ait sa propre identité, tout en conservant la nervosité, l’inquiétude qui la caractérise. Je voulais que ce tempérament guide le mouvement du film.
Voyez-vous une vraie frontière entre votre travail vidéo et vos films de cinéma ?
Oui c’est différent. En tout cas, cela l’a été jusqu’à présent pour Big Boy et Nervous Translation. C’est un tel travail d’équipe, cela implique de collaborer avec tellement de monde ! Mais comme je suis timide, je pense que c’est une expérience par laquelle je dois passer, pour m’ouvrir aux autres et communiquer, c’est comme une thérapie pour moi. Mais après, je dois retourner dans ma grotte et travailler seule.
À vos yeux, Nervous Translation est bien plus narratif que vos autres travaux ?
Oui je crois. Le moule est différent. Mais il y a des similarités. Le processus est très différent, ne serait-ce qu’en termes de financement, il faut démarcher des producteurs, faire des sessions pendant lesquelles on pitche le film, passer devant des commissions... Mais une fois que j’ai le financement, c’est là que ma liberté commence, et je peux dévier un peu du scénario. Une fois sur le plateau, l’adrénaline monte et j’aime être confrontée aux décisions du plateau, me poser la question de savoir comment je vais cadrer un plan, comment je vais gérer finalement le rapport entre ce qui est prévu et ce qui se présente à moi sur le moment. Le processus devient plus ouvert, moins figé.
Mais ces deux façons de faire des films sont pour vous naturelles, vous ne vous sentez pas obligée d’en dire plus ou d’expliquer plus, de montrer plus dans vos films de cinéma ?
Non, je suis toujours mon instinct et je finis toujours par poser plus de questions que je ne donne de réponses. J’aime les œuvres qui vous incitent à les revoir. Je peux apprécier des choses plus divertissantes qui ont un début et une fin et qui ne vous laissent pas sur un sentiment d’inachevé, mais j’aime aussi les films intrigants, qu’il faut revoir, qui ne sont pas fermés voire pas totalement achevés.
Quelles sont vos influences en cinéma ?
Plus jeune, j’admirais beaucoup Bresson et Tarkovsky. Mais pour Nervous Translation, je me suis beaucoup inspirée de Kasaba de Nuri Bilge Ceylan (1997) et de The Spirit of the Beehive de Víctor Erice (1973).
Entretien réalisé par Lucas Charrier le 30.09.21 dans le cadre du Let Us Reflect Film Night pour le Centre d’Art Contemporain Chapelle Saint-Jacques en partenariat avec Le Printemps de Septembre de Toulouse.
Shireen Seno est une vidéaste, réalisatrice et artiste plasticienne née en 1983 à Tokyo dans une famille philippine. Elle a étudié l’architecture et le cinéma à l’Université de Toronto. Son premier film Big Boy (2012) a été présenté au Festival international du film de Rotterdam. Son deuxième long métrage Nervous Translation (2018) a été montré au MoMA et à la Tate Modern. Elle est commissaire d’exposition, elle co-dirige la société de production Los Otros et fait partie du collectif Tito & Tita. Son travail navigue entre le cinéma et les arts plastiques et s’intéresse à la mémoire, à l’Histoire et à la fabrication des images souvent en lien avec la notion de foyer.
︎︎︎ shireenseno.tumblr.com
︎︎︎ shireenseno.tumblr.com