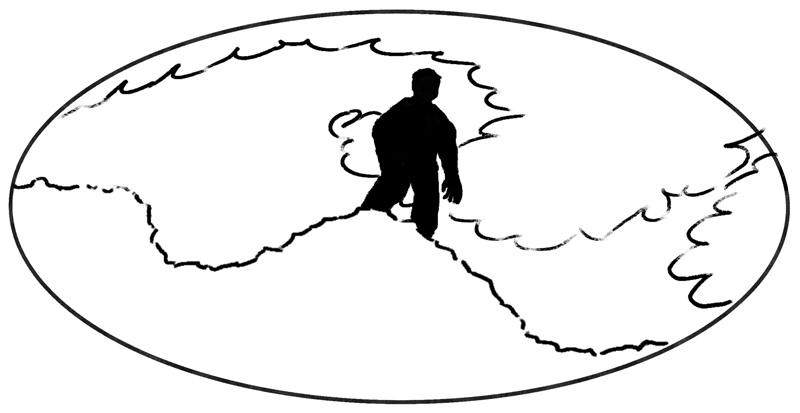Questionnaire
Paul Heintz







Quels sont les films qui ont marqué...
Votre adolescence
— Monde de Gloire de Roy Andersson
— L’homme sans passé d’Aki Kaurismäki
— Lost Highway de David Lynch
— Les film du Dogme 95
Votre vie d’adulte
— Avec le Sang des Autres du groupe Medvedkine
— Le Plein Pays d’Antoine Boutet
— L’été de Giacomo d’Alessandro Comodin
— Ultranova de Bouli Lanners
— La Commune de Peter Watkins
— Playtime de Jacques Tati
Enfant, qui vous montrait des films, comment avez-vous eu accès au cinéma ?
J’ai grandi à Forbach, une petite ville minière, et il y avait, il y a toujours, un seul petit cinéma qui se nomme le Paris. Je n’ai pas eu de passion pour le cinéma dés l’enfance. Plutôt que le cinéma, c’était les histoires qui m’intéressaient je crois. Comme pas mal d’enfants j’aimais beaucoup me raconter des histoires, raconter des bobards dans la cour de récréation, m’inventer une vie, crâner. Mais surtout écouter les histoires des gens déjà je crois. Je questionnais beaucoup mes parents sur la vie des adultes et mon père lorsqu’il rentrait du travail, il travaillait pour les Houillères du Bassin de Lorraine. Et la mine était pleine d’histoires. On allait très peu au cinéma quand j’étais petit mais je me rappelle qu’on regardait des séries d’enfants et des dessins animés à la télévision. Enfin, comme dans certaines familles, il y avait des heures pour la télévision. Du coup c’était par moments, le soir, puis un peu le week-end. J’aimais Sabrina l’apprentie sorcière et son chat noir Salem, je me rappelle qu’il parlait et était étrangement articulé. Petit encore, je me rappelle du dimanche soir avec mon frère, on se ratatinait sur le canapé pour regarder Ça cartoon sur Canal +. Avant la venue d’internet à la maison familiale et les périodes de découverte et de téléchargement de films, il me semble que j’ai pu faire de belles découvertes de films sur Arte. Mes parents étaient abonnés à Telerama, ce journal télé représentatif de la classe moyenne intellectuelle, avec des critiques de films et de programmes culturels. J’ai l’impression que c’était même par là que j’ai découvert le cinéma réaliste et le cinéma social : les frères Dardenne, Ken Loach à l’adolescence. C’est quelque chose que j’ai tout de suite beaucoup aimé, les chroniques, les films qui racontent un quotidien. En ça, mes goûts s’opposaient déjà à ceux de mon frère qui lui aimait les blockbusters et le fantastique. C’était la période du Seigneur des Anneaux puis de Pirate des Caraïbes. J’étais peut-être un gamin snob. Ensuite j’ai grandi et j’ai fait des études d’arts appliqués et de beaux-arts. Je crois que j’ai découvert les films à travers des oeuvres plutôt performatives en art visuels. Il y a eu le geste, la performance d’abord, puis plus tard le documentaire. Les performances filmées de Bas Jan Ader m’ont beaucoup touché à l’époque, les réveils de Pierrick Sorin, mais aussi Jacques Lizène. Des protocoles, des gestes proches des démarches telles que celles de l’Oulipo et Georges Perec puis ensuite aux Arts-décoratifs, on était tout un groupe d’amis étudiants passionnés de documentaire, alors j’ai découvert ça à ce moment-là, par mes amis. Je crois bien que c’est un cinéaste comme Luc Moullet qui a fait la jonction de mon parcours d’art visuel vers le cinéma documentaire. Sa posture sociologique et comique, sa logorrhée. J’ai tout de suite adoré. À ce moment-là, je crois que Essai d’ouverture où Luc Moullet tente d’ouvrir une bouteille de Coca-Cola pendant 15 minutes, était la plus belle performance filmée que j’avais vu. Ça me parlait : de l’absurde, un micro-conflit du quotidien qui me racontait bien plus. Puis après j’ai fait mes premiers films, toujours en plan-séquence, parce que j’avais peur du montage. C’était des actions simples qui ressemblaient à de petites capsules cinématographiques. Je croyais uniquement au temps réel. Dès la fin de mes études, j’ai eu des amis qui étaient très cinéphiles et ils me conseillaient des choses à regarder. Des documentaires toujours, mais qui s’autorisent beaucoup de mise en scène, de fiction. J’adorais les portraits documentaires (Antoine Boutet), les journaux filmés (Alain Cavalier, Olivier Smolders). Ça faisait sens pour moi quand des histoires intimes, des confidences et gestes mettent en critique les difficultés du réel, les luttes. Il y a un film de Manuela Frésil, Entrée du personnel, qui m’avait beaucoup touché. Je pense en l’occurrence à une scène où un groupe de travailleurs d’abattoirs industriels se mettent ensemble à mimer, sur un rond-point devant leur usine, leurs gestes. Raconter leur métier autrement, une danse.
Racontez-nous un souvenir de cinéma.
Je me rappelle l’une des premières fois que je suis venu montrer un film dans un festival étudiant. Le festival s’appelait La Première Fois d’ailleurs et les projections se tenaient à l’école d’art d’Aix-en-Provence. C’est là que j’ai rencontré Luc Moullet dont j’adorais le travail. J’étais jeune et très timide mais je me suis permis d’échanger avec lui. Je me rappelle lui avoir indiqué que ce que j’aimais dans ses films c’était l’humour à froid, distancé, pour raconter des choses graves. Il m’avait répondu par une citation : « L’humour est la politesse du désespoir ». Même si on a passé le déjeuner ensemble à tenter de savoir qui était à l’origine de cette phrase, cette idée m’a beaucoup marqué. Je crois qu’en effet c’était aussi ça que j’essayais de chercher. Plus que la politesse, une manière dont le comique pourrait nous raconter une certaine violence, nous permettre une certaine distance. Une rencontre de cinéma fondamentale pour moi était aussi Michel Vandestien. Je l’ai rencontré parce que je l’interviewais pour une création sonore que je faisais pendant mes études. Michel était connu dans les années 1980-1990 parce qu’il avait dessiné et construit les décors de Léos Carax, en l’occurence ceux des Amants du Pont-Neuf. On est tout de suite devenus amis, j’avais même l’impression qu’il était un père pour moi. Je venais fréquemment le voir à Montreuil et il me partageait sa pratique de la peinture, ses magnifiques archives de construction de décor (les à-côtés, le travail du cinéma me fascinait). Michel adorait s’inventer des personnages, il a ensuite fait la voix de mon film Foyers en 2018, puis je l’ai filmé en 2022 dans Dedans c’est à l’intérieur, avant qu’il ne quitte sa maison. Je n’oublierai jamais la générosité et la belle spontanéité créative que Michel avait. Il ne pouvait s’arrêter de créer, avec du papier, un bout de ficelle. Il avait toujours quelque chose avec lui, c’était un inventeur de forme. Et une maison pleine d’histoires, composée de reliques de décors passés. Même s’il est décédé à présent, je pense tous les jours à lui lorsque j’allume un néon qu’il m’a offert et que j’ai installé chez moi. C’est le néon du décor de l’institut de beauté du film Vénus Beauté Institut de Tony Marshall. Deux visages, les visages rougeoyants des amoureux.
Que regardez-vous dans les films ?
J’aime très souvent regarder les situations plus que la narration dans les films. La dynamique de mouvement entre les protagonistes au sein d’une scène. Je pense que c’est pour ça que j’ai tout de suite beaucoup aimé les cadrages tableaux et que j’ai moi-même commencé à filmer mes films en plan large. Les personnages en pied. C’est presque considérer les films comme de petits théâtres plutôt qu’en termes de découpage. Le travelling, le champ contre champ, le gros plan, tout ce langage issu du cinéma et de son industrie n’était pas quelque chose de naturel pour moi. D’autant plus pour des raisons économiques : j’ai commencé à faire des films seul, du coup je posais la caméra en plan large sur pied. Donc oui d’emblée c’est le rapport entre un sujet et un décor, l’architecture qui m’a intéressé. Regarder un film comme un rapport chorégraphique avec un espace. Il y a une scène du film Le Grand Soir de Kervern et Delépine à laquelle je pense quelque fois encore et qui raconte ce rapport-là. C’est le personnage incarné par Benoît Poelvoorde qui se bat avec un petit arbre sur un terrain en jachère en périphérie d’un parking de supermarché. Je ne sais pas, c’est un sentiment qui raconte beaucoup et j’ai l’impression que ces zones géographiques, le périurbain, je les connais bien. Enfin c’est là où j’ai grandi.
3 mots que vous associez au cinéma ?
Chambre, chance, la face B de…
Citez…
Un film qui vous fait peur :
— Inland Empire de David Lynch
Un film qui vous fait rire :
— Orange Sanguine de Jean-Christophe Meurisse
Un film qui vous fait pleurer :
— Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma
Un film dans le quel il fait bon se perdre :
— Les Chiens Errants de Tsai Ming-Liang
Un film surestimé :
— Les palmes d’or après les année 2020
Un film sous-estimé :
— Super Mario Bros., le film de 1993
Un film dont vous aimez particulièrement l’ouverture :
— Le gang des bois du temple de Rabah Ameur-Zaïmeche
Un film dont vous aimez particulièrement la fin :
— Désordre de Cyril Schaüblin
Qu’est-ce qui vous émeut au cinéma ?
Quand ça sonne faux. Les désynchronisations son et image par exemple. Lorsque qu’on enlève toutes les ambiances et qu’on garde juste une respiration ou une voix.
Qu’est-ce qui vous impressionne au cinéma ?
Je sais pas, les choses un peu fragiles, les trucs bancales, les relations entre la personne qui filme et celui qui est filmé.
Qu’est-ce qui vous amuse au cinéma ?
Les ratages.
Quels sont les films (et séries) qui vous habitent ?
Je reviens très souvent au film Avec le sang des autres de Bruno Muel, membre du groupe Medvedkine, pour ses récits polyphoniques des conditions de travail dans les usines Peugeot dans les années 1960-1970. Surtout à la fameuse séquence sur les mains, un des plus beaux entretiens documentaires dans un film sur la violence du travail à l’usine.
Parlez-nous d’une maison de cinéma qui vous a marqué.
Je ne suis pas très maison, mais ça me fait penser au court film Deadpan de Steve Mc Queen où il reprend, en performance filmée, la scène du film de Buster Keaton Steamboat Bill Jr de 1928. C’est un espèce de remake de la scène où l’artiste reste debout, et un pan entier de la maison tombe violemment vers lui, sans l’écraser parce qu’à chaque fois sa figure tombe à l’endroit de la fenêtre. Une telle violence, un suspense à chaque plan. Et un montage incroyable. Je me rappelle quand j’ai vu ce film pour la première fois, c’était peut-être au Centre Pompidou quand j’étais étudiant. C’est une maison qui s’effondre, ce qui rejoint ma passion pour les décors, le goût pour les protocoles et la performance.
Quels sont les paysages de cinéma que vous rêveriez d’explorer ?
Les forêts de Weerasethakul, ou celles, plus diffractées et sonores, de mon ami Eduardo Williams. J’ai été très ému lors de voyages passés de découvrir des forêts, quelques fois tropicales, surtout lorsqu’elles se mêlent à la ville, ses tours, ses poteaux et câbles électriques. Par moment la forêt tresse la ville. Hong-Kong et ses bordures de jungle ou la forêt de Tijuca à Rio de Janeiro qui enlace la ville. Des collines touffues, denses, qui se glissent dans chaque interstice du béton. La forêt est forte. Alors que l’eau est prête à tous nous engloutir, je me dis que les forêts sont bien plus fortes que nous. On attend, on tremble, dans nos petits blocs de béton.
Qu’est-ce qui est cinégénique à vos yeux ?
Une usine, une voiture, un visage.
Quels clichés vous agacent terriblement au cinéma ?
Les automatismes de découpage de certains films commerciaux.
Quels clichés vous plaît secrètement au cinéma ?
J’aime bien le faux suspenses avec beaucoup d’effets dans les films d’Hollywood, dans certaines séries. J’aime bien les musiques planantes de David Lynch, qui crée du faux mystère aussi. Lynch c’est une machine à clichés de la culture américaine, c’est ça qui est assez drôle.
Qu’est-ce que vous faites quand vous vous ennuyez devant un film ?
Sur mon ordinateur je coupe, au cinéma je reste toujours jusqu’à la fin.
Pourquoi faites-vous du cinéma ?
Je suis artiste visuel et je fais des films. Je fais des films pour enregistrer le réel, le documenter. Documenter des rencontres qui n’ont quelques fois lieu que lors du tournage. Je crois fort à un art documentaire. Un art qui documente nos conflits intérieurs mais aussi notre société. Je fais du cinéma parce que beaucoup de choses dans le réel me révoltent. La violence dans le monde du travail, la montée d’un nouveau fascisme, propulsé par le monde de la tech. On est tous en train d’essayer de surnager là-dedans, du coup je me dis que le cinéma ça m’aide à un endroit, à y réfléchir avec d’autres. Je fais du cinéma aussi parce que je crois en l’expérience du film plutôt que l’objet fini, le film. En tant qu’artiste visuel, on est souvent amené à travailler seul, alors qu’en faisant des films, je me propulse dans la réalité de quelqu’un et on fait quelque chose ensemble. Ça nous déplace. Le travail avec l’équipe aussi m’aide beaucoup. Il y aurait aussi des raisons économiques pour moi à faire des films. Les artistes visuels n’ont pas le droit à une continuité de revenus, ce que les arts du spectacle et le cinéma ont : l’intermittence du spectacle. Je me demande parfois si je fais aussi des films pour les conditions économiques que l’industrie du cinéma permet. En tous cas cette question de l’économique qui contraint la forme me taraude souvent. Quoi qu’il en soit ce statut me permet de mieux travailler, plus calmement qu’il y a plusieurs années. Le syndicat des artistes visuels, le SNAP CGT, défend actuellement une proposition de loi pour une continuité de revenus chez les artistes et auteurs, ce qui permettrait à l’ensemble de mes camarades artistes de vivre dignement. Afin de résoudre cette injustice de secteur. Il faut que les choses évoluent, on est en 2025. Tous les artistes ne s’inscrivent pas pleinement dans le marché de l’art, je crois qu’il est nécessaire de rémunérer le travail et le temps de travail de chaque artiste. On est beaucoup à travailler sans rémunération, de trop nombreux amis artistes galèrent pour payer leur loyer, d’autres sont au RSA pour pouvoir survivre. Quand on sait que l’industrie culturelle en France est celle qui génère le plus de richesse. Il est temps de résoudre cette injustice qui concerne notre secteur.
Que feriez-vous si vous ne faisiez pas du cinéma ?
Mon moment de création à moi c’est le tournage, cependant j’admire mes amis peintres ou sculpteurs qui ont une pratique d’atelier. Je pense que si je ne faisais pas de cinéma, je m’essayerais à ce genre de choses. C’est déjà le cas quand j’écris je trouve. Je travaille moi-même dans un atelier et mes voisins, voisines d’atelier sont toutes et tous peintres. Avec le travail du texte, je rassemble des archives diverses, je retranscris des paroles issues d’entretiens et je compose, j’assemble, un peu comme en montage. Il y a déjà quelque chose de similaire à la sculpture, à l’assemblage avec le travail du texte, cependant ce qui me manque beaucoup lorsque je ne suis pas en tournage, c’est la matérialité. Le texte je l’écris sur l’ordinateur. C’est très précaire un ordinateur. Si mon ordinateur crash, mes assemblages de texte disparaissent. Bref, je rêve de faire de la sculpture, de pétrir la pâte, de faire du pain et je rêve d’écrire des livres aussi.
Comment décririez-vous votre cinéma en quelques mots ?
Je fais très souvent des petits films et même s'ils concentrent beaucoup de choses, j’essaye de trouver des manières de les faire rapidement. Un film correspond toujours à un moment, ça peut être une année, les résonances avec l’actualité, un évènement personnel. C’est toujours difficile pour moi quand un film met du temps à se faire car j’ai toujours peur d’être en décalé avec l’intuition d’origine. J’ai l’impression que c’est un cinéma avec des réflexions sociales. Souvent je pars de la rencontre avec quelqu’un, avec une communauté ou des archives et j’essaye de mettre en tension critique les choses. Ça me pose beaucoup de questions, comment on deale avec l’autorité ou la norme sociale, l’accepter ou la rejeter, s’arranger avec, hacker le système. De quelle manière on résiste. Ces dernières années, je me suis pas mal pris la tête avec des questions liées au travail, aux mondes du travail. Comment peut-on accepter tant de choses des nouvelles mutations du travail et du système capitalisme dans lequel on vit ? Des nouvelles techniques de management, aux souffrances et à la solitude que provoque fréquemment le travail. Le travail de l’artiste ou de l’auteur n’est pas décorrélé de ces questions, on pourrait simplement y ajouter d’autres difficultés encore liées aux popularités éphémères propres au système de la culture. Toutes ces choses scandaleuses, y compris que le travail continue de tuer… même douze ans après le Rana Plaza, même après France Télécom.
Qu’est-ce qui vous inspire ?
Quelqu’un qui bouge ça m’inspire, quelqu’un qui prend plaisir à poser sa voix ça m’inspire. La voix c’est un petit théâtre. L’inconnu ça m’inspire. L’absence aussi, les dynamiques de groupe. La poésie arabe ancienne ça me passionne. Les chevaliers, l’impossibilité de l’amour. Les poètes ouvriers comme Thierry Metz ou Joseph Ponthus. Les textes de Brecht sur le théâtre ou de Camus sur l’absurde ça m’inspire. Après généralement, il y a plutôt des choses qui me révoltent. Ça me fait penser à un entretien de Godard, où il disait qu’il travaillait ou il faisait du cinéma pour « penser contre quelque chose ». Il y a cette idée d’opposition ou de bataille.
Décrivez en quelques mots un film auquel vous rêvez.
Ce serait l’histoire d’un groupe qui tente de faire ensemble une expérience de liberté, de liberté en commun. C’est quoi la liberté ? Ils seraient sur un radeau ensemble, ils traverseraient la ville, la mer. Puis il y aurait même des chanteurs. C’est un film dans lequel il y aurait pas mal de chants. Les chanteurs seraient comme un choeur omniscient dans le théâtre antique, ils nous raconteraient l’histoire d’un point de vue extérieur mais aussi l’inconscient des personnages. Ce qui les tiraille : leurs désirs, leurs amours. Bon, ce serait un peu lyrique. Mais ce serait libératoire aussi. Il y aurait un scénario à suivre au début du film mais au fur et à mesure les protagonistes n’en auraient plus vraiment besoin. Parce que les personnages n’ont pas besoin de scénario pour se mettre en mouvement. Les personnages il respirent, il bougent, en bordure du texte, ils attendent juste qu’on les regarde.
Quels films auriez-vous aimé réaliser ?
La Commune de Watkins est pour moi un film incroyable, qui m’inspire beaucoup dans sa réflexion politique, sa démarche de jeu fiction documentaire. Alors que j’étais en résidence aux USA, j’ai eu la chance de le revoir dans sa version longue, il y a quelques mois pour les 25 ans du film dans le cinéma mythique Anthology Film Archives à New-York. J’aime pas trop les films longs mais devant ce film je ne me suis ennuyé à aucun moment. Au-delà des théories de Watkins sur la Monoforme, ce qui est magnifique ce sont les glissement de rôles. Les préoccupations intimes et politiques des communards et des royalistes dans le film se révèlent progressivement : qu’est-ce que le travail aujourd’hui ? Qu’est-ce que le capitalisme nous fait ? Des vraies questions de féminisme aussi. Je le trouve précurseur alors que c’est un film qui date de 2000. Ce type de travail de Watkins de réflexion sur l’histoire et le présent est très impressionnante, honnête aussi, car c’est présenté ni plus ni moins comme un grand film d’atelier. Ils sont un groupe et se sont réunis sur une dizaine de jours dans un décor et nous restituent leurs tentatives. Je crois que j’aime ça aussi parce qu’il y a quelque chose de direct et que les films sont beaux quand ils sont des esquisses.
À votre avis pourquoi le cinéma est-il un art si populaire ?
Parce que c’est un art documentaire, parce qu’on arrive à se regarder vivre pour un instant, parce qu’on tente de regarder l’autre et que parfois on voyage.
Quelles sont les sensations que vous procure le cinéma et que vous ne trouvez pas ailleurs ?
Comme je ne suis pas cinéphile et que je viens d’un background plutôt arts visuels et exposition, ça a été une belle découverte pour moi les projections de film, la séance, les festivals de films où tous les spectateurs sont réunis pour un temps pour regarder un écran ensemble puis ensuite discuter des films après la projection. Le principe de la projection, du moment de partage ensemble sur un temps donné est quelque chose d’assez beau. On est tous en co-présence, il y a ce côté de multitude de solitudes en partage devant une projection lumineuse, puis ça raconte. Ça me ramène aux formes assez archaïques de réunions, comme certaines cérémonies de connexions avec la lumière, les astres : la caverne de Platon, les ombres et réflexions, se réunir devant une éclipse ou devant le feu de la cheminée. Les ondulations des réflexions du soleil sur la mer Méditerranée c’est le meilleur film quisoit.
Et inversement, que trouvez-vous ailleurs que vous ne trouvez pas dans le cinéma ?
Ces dernières années je lis beaucoup plus que je ne regarde de films. Ce que j’aime beaucoup avec la lecture c’est le rapport au texte, à la projection imaginaire bien sûr. Mais aussi le fait qu’on peut fragmenter son parcours : lire en partant de la fin du livre, lire des morceaux, lire dans le train, lire la nuit. Moins technique ou technologique, le livre est une invention incroyable. C’est à la fois un espace intime, de projection, c’est pour soi. Puis un livre ça se donne et ça circule. On peut même l’abandonner quelque part.
Avec quelles autres pratiques artistiques votre travail dialogue-t-il le plus ?
J’ai l’impression que de plus en plus, mon travail est en lien avec les arts vivants. Le théâtre, la danse, les démarches d’art vivant documentaire qui se développent depuis quelques années. Je pense à ça dans le fait qu’il y a certes toujours une volonté de documenter le réel chez moi mais aussi toujours ce goût pour la situation, la performance, la mise en scène de la parole. Un espace de tournage même si c’est pas une scène de théâtre possède ce truc-là, du « rendre visible ». Ce qui est bien avec le cinéma c’est que c’est moins spectaculaire et qu’on est pas obligé de hausser la voix pour se faire entendre. Et puis quand on fait du documentaire, ce qui est très beau c’est qu’un objet du quotidien peut devenir en un instant un objet de mise en scène, un accessoire de fiction. D’un moment à l’autre, alors qu’il n’y a pas tous les projecteurs et qu’on est pas sur scène, on peut glisser ailleurs. Je repense quelques fois aux propositions et aux expériences qu’on avait faites avec mon film Character, inspiré de l’idée du speaker corner de Hyde Park à Londres, cet endroit où des londoniens viennent dans l’espace public pour dire des discours politiques ou religieux debout sur des escabeaux ou des tabourets. Avec l’un des personnages du film, on s’était demandé ce qu’il se passerait si on déplaçait plutôt un discours intime, un écrit personnel et poétique et qu’on le déclamait debout sur un tabouret. Ces petites choses qu’on s’échangeait en entretien sonore, on avait voulu les mettre de manière directe. Un tabouret n’est-il pas un espace scénique accessible à tous, pour transformer le quotidien en théâtre du quotidien ?
Si on faisait un film sur vous ce serait un film sur quoi ?
La solitude dans la grande ville. Ça me fait rire quand je dis ça parce que je pense à mes amis, le scénariste Quentin Faucheux-Thurion et la monteuse Jeanne Sarfati, c’est eux qui me soufflent ça. Ce sont toujours nos plus proches amis et nos proches qui nous regardent travailler et vivre qui nous disent le mieux ce qu’on fait.
Est-ce que vos films vous ressemblent ?
Je ne sais pas trop si mes films me ressemblent mais j’ai l’impression à chaque fois de vouloir faire un cinéma très instantané, très direct en début d’écriture, puis de nombreuses idées viennent s’agglomérer. Ça devient toujours beaucoup plus complexe et c’est bien sûr réjouissant ce trajet, car ça passe souvent par la rencontre. Un film ce n’est pas vraiment une fin en soi, je n’ai aucun fétichisme pour mes films et pour la forme. Un film ça ne reste toujours qu’une proposition à un instant T de sa fabrication. J’essaye qu’il reste ouvert, recomposable, que ce ne soit pas un bloc monolithique. Je ne sais pas si mes films me ressemblent mais en tout cas ils m’aident à me comprendre et à comprendre d’autres personnes, très loin de moi, très loin de mon quotidien.
Paul Heintz est né en 1989 à Saint-Avold, diplômé des Beaux-Arts de Nancy, des Arts Décoratifs de Paris et du Fresnoy, studio national des arts contemporains. Il vit et travaille à Paris 19ème. Ses films ont été présentés lors d’évènements d’art contemporain et festivals de films tels que FID Marseille, IFFR Rotterdam, Visions du Réel, Paris Nuit Blanche, et dans des centres d’art et musées comme le Centre Pompidou de Paris et de Metz, les FRAC, Les Rotondes au Luxembourg ou Le Confort Moderne à Poitiers. Il est le lauréat du prix Révélation Emerige 2019, Révélation Livre d’Artiste 2021, 1% Marché de l’Art 2023 ou plus récemment du Prix Talents Contemporains de la Fondation François Schneider pour son film Nafura. Il développe un travail filmique, dans un mode entre documentaire et fiction, où le réalisme est souvent remis en jeu par les personnages ou acteurs eux-mêmes. Le rapport à l’autorité et la soumission au pouvoir sont des sujets récurrents dans ses réflexions.
︎︎︎ Paul Heintz
images : Nafura de Paul Heintz produit par Macalube Films.
︎︎︎ Paul Heintz
images : Nafura de Paul Heintz produit par Macalube Films.