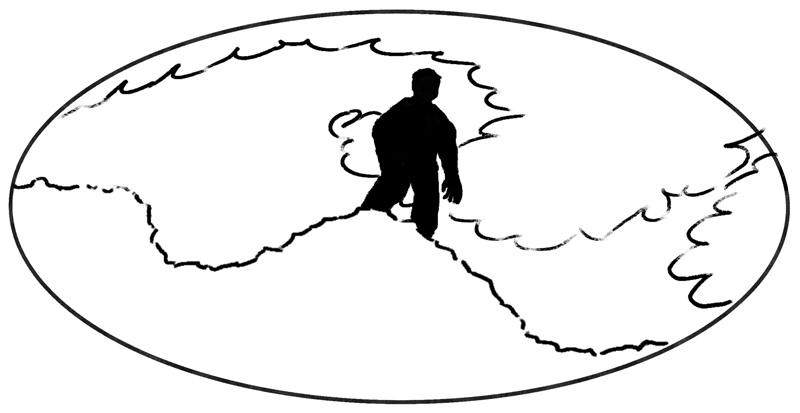L’endroit du décor
Lucas Charrier


Deux mouvements simultanés agissent en
lame de fond dans le cinéma d’Andrés Baron : une patience, un état quasi méditatif (qui
trouve un écho dans l’expérience spectatorielle), un temps de répétition extrêmement
méthodique et rigoureux contraint par les limites de tournages en pellicule qui ne laissent
que très peu de place à l’erreur. L’autre mouvement se nourrit lui précisément de cette
marge d’erreur qui persiste malgré tout, d’une
forme d’improvisation, de collisions de formes
et d’idées, de circulation et de porosité, de
fabrication collective et participative au cours
de laquelle chaque acteur du film, chaque élément, chaque outil doit trouver sa place. Faire
sa place. Andrés Baron filme des motifs et des
corps, joue et rejoue des gestes simples, mais il
filme aussi surtout des interactions, entre tous
les types de performeurs qui agissent dans le
cadre (entre les acteurs et le décor, les acteurs
et la caméra, la lumière et les surfaces...). Là
un regard caméra, ici une ombre, un reflet,
une main qui s’affaire... L’intervention de cette complicité collective est essentielle car elle
permet un assouplissement des protocoles et
un glissement tout en douceur vers une forme
de collage minutieux de motifs dont la friction, presque aléatoire et autonome, produit
parmi les plus belles rencontres de cinéma qui
soient. L’exemple le plus parlant tient peut-être dans le diptyque Red Logics, où deux
images réunies par un split-screen étonnant
(d’un côté une main dessine des cercles rouges
sur une feuille blanche, de l’autre un chien se fait peigner les moustaches sous un arbre)
dialoguent, côte à côte, dans un seul et même cadre au rythme d’une mélodie lancinante.
Ses films sont des gestes d’une grande musicalité, des mouvements exécutés avec la grâce et
le sérieux d’un athlète dont les échauffements
feraient partie intégrante de la performance. Il y a toujours dans l’image quelque chose
qui nous tient en haleine et qui contrevient à l’assoupissement que la cadence des images
suggère. Comme une tension qui s’installe
dans la durée, dans la lenteur des ralentis, et
suggère qu’une logique supérieure anime
l’ensemble. Une bascule s’opère et retourne les films sur eux-mêmes. On entre peu à
peu dans un espace liminal, un seuil, un entre-deux qui détourne l’imaginaire du cinéma, ses outils et ses codes, pour les mettre au
service d’une pratique à la fois lyrique et cérébrale du portrait. Andrés Baron invente son
propre langage, non-verbal, physique et sensoriel, en images (filmées, imprimées, pliées,
dépliées, affichées...) et en sons, il emprunte,
ré-utilise, assemble tout ce qui peut lui permettre de faire surgir une émotion, d’évoquer
une idée, de solliciter les sens, de travailler
une narration, par vignettes, boucles et fragments. L’envers et l’endroit se confondent. Ce
pourrait être ça le territoire d’Andrés Baron : l’endroit du décor. Tout un monde, sans
dessus ni dessous, qui crée du réel à partir du
factice, et inversement. Tout un monde, merveilleusement concret, qui se déplie sous nos
yeux comme le patron d’une maquette dont il
filmerait le moindre pli.