Les ponctuations invisibles
Julien Gester
![]() Comment partagez-vous votre vie entre la pratique de la photographie et de la critique de cinéma ?
Comment partagez-vous votre vie entre la pratique de la photographie et de la critique de cinéma ?
Je suis venu à la presse par la critique, il y a près de vingt ans, et j’ai en effet surtout écrit sur le cinéma, avant que mon parcours récent ne me fasse m'en éloigner, pour devenir correspondant de Libération aux États-Unis. Parallèlement, j’ai toujours été travaillé par un intérêt pour la pratique photographique, qui m’a conduit à produire des images, sur une base très régulière, pas quotidienne mais presque, depuis l’adolescence. Cette production, pendant très longtemps, n’a au fond concerné que moi, et éventuellement les gens que je photographiais. Mais depuis quelques années je commence à montrer ces images, et la question de la diffusion est devenue un champ de réflexion, d’expérimentation en soi, qui m'intéresse beaucoup. Il y a évidemment énormément d’images qui dorment sur des disques durs, qui pour l'essentiel n’en sont jamais sorties, et c’était, c’est toujours, très bien comme ça. Ça ne fait que trois ou quatre ans sur plus de vingt ans de production d’images — une pratique longtemps tout à fait désintéressée à l’endroit de sa diffusion — que ma recherche visuelle s'est précisée au point de me dire que ça pouvait avoir un sens pour moi de les montrer, et de me poser la question du comment. Donc à quel point tout ça s’articule, l’écriture sur les images des autres, la fabrique des miennes ? Je ne suis pas sûr. En pratique, je fixe fatalement des images sur la base d’intuitions qui sont fondées sur l’expérience d’autres images. Car, comme tout le monde, je perçois ce qui m'entoure à travers d'autres images, celles que j’ai dans la tête, celles qui me plaisent, comme celles que je subis. Des images de cinéma et d’autres, mais évidemment celles du cinéma occupent une place importante là-dedans.
Est-ce que vous arrivez à voir comment l’écriture sur le cinéma a aiguisé votre regard de photographe ?
Encore une fois je pense qu’on reconnaît toujours des images autant qu'on les fabrique, à partir de celles qu’on a en soi, qu’on les ait choisies ou reçues de différentes manières. Mon activité critique est désormais un peu tenue à la marge de mon travail journalistique, mais mon intérêt pour le cinéma, ma vie de spectateur mobilisent des questionnements, des réflexions face auxquels chaque film vu se pose comme un nouveau problème à résoudre. Et je serais fou ou naïf d’affirmer que je n’en fait aucun usage dans ma production d’images. Certes, j’établis une ligne de partage claire entre le cinéma et la photographie, qui ne me nourrissent et ne me travaillent pas du tout de la même manière. D’autant que j'ai le goût de photographier, alors qu’écrire à partir des films était pour moi une fin en soi, je n’ai jamais eu aucune velléité de faire du cinéma. Mais évidemment que les deux sont confrontés à une même matière première — que je me méfie toujours un peu d’appeler « le réel » — et que dans leur relation à cette matière sensible, vécue avant d'être captée et représentée, ils se confrontent à des questions similaires. Quand j’essaie de comprendre ce que soulève pour moi l’expérience d'un film, cela dépose en moi des choses qui de manière consciente ou pas façonnent mon regard. Mon regard face au monde au moment où j’en fixe quelque chose par la prise de vue, soit un processus qui va très vite, au moins autant que cela affecte mon regard ensuite face à mes photographies, dans le temps long, très long, où j’essaie de comprendre ce que j’y vois et à quel point cela m’intéresse toujours. C’est une banalité à dire mais une part cruciale de ce qui va définir un travail se joue dans le choix des images qu'on décide de montrer entre toutes celles qu'on produit. Je pense que c'est particulièrement vrai dans ce premier livre que j’ai publié, Cette fin du monde nous aura quand même donné de beaux couchers de soleil : il a trouvé pour moi son sens au moins autant par les photographies qui y figurent, et la façon dont elles sont agencées entre elles, que dans le choix de ne pas y mettre d'autres qui auraient pu en être. Celles qui le composent ont toutes été produites ces quatre ou cinq dernières années, et à partir du même corpus le livre aurait pu être très différent, ou beaucoup plus imposant. Mais l’idée initiale, mûrie à partir de l’automne 2019, était vraiment celle d'un objet conçu pour être rapide, léger. Avec la crise sanitaire, il a été freiné, bloqué pendant un temps, et il a muté, largement dévié de ce que je pensais publier courant 2020, même si le principe général reste le même.
Est-ce que la recherche d’un récit à partir d’une matière, qu’on va dire documentaire, via le séquençage ici sous forme de diptyques, est quelque chose qui vous travaille ?
Oui. Il y a à mes yeux diverses choses qui font tenir entre elles les images qui composent ce livre, mais l'une des plus centrales est en effet la question de la fiction. Sur la dimension « documentaire », c’est compliqué. Au cinéma ça fait longtemps que pas mal de gens disent qu’au fond ces catégorisations-là ne sont pas très pertinentes ni agissantes. Plein de cinéastes parmi les plus intéressants se situent à un point de friction de ces vieilles polarités-là, qu’il n'y a aujourd’hui plus grand sens à opposer. Dans mon activité photographique, je peux être amené à invoquer l’étiquette documentaire pour qualifier le régime de production de mes images, au sens où j’ai le moins d’interaction possible, en général aucune, si ce n’est par ma seule présence, avec ce que je photographie. Je n’interagis pas avec les sujets dans mon cadre, sauf éventuellement si les personnes viennent me questionner après m'avoir vu déclencher. Je peux donc m’attacher à ce terme, « documentaire » ou alors on pourrait dire « contemplatif », au sens où j’interviens aussi peu que possible sur ce que je fixe de ce que j’ai trouvé, tel quel.
Est-ce que ça produit pour autant des images documentaires ? Ce qui est sûr c’est que ces images commencent à m’intéresser quand j’y vois la possibilité de la fiction. Quand on peut y projeter quelque chose qui aurait eu lieu avant ou après, des fragments d’expériences, vécus ou fantasmés. Photographier c’est un moyen que j’ai trouvé pour documenter quelque chose qui m'a intéressé visuellement et pour pouvoir étirer cet intérêt dans le temps. Cet attrait de ce que j’ai vu et fixé ne rend pas l’instant particulièrement décisif : moi je fixe plutôt des instants indécis, qui m'intéressent parce que je ne suis pas sûr de ce que j’y vois, de ce que ça dit. La photographie me permet de tirer le fil de cet intérêt, de l'ambiguïté à laquelle il s'accroche. Enfin, il y a une autre fonction, peut-être même la première au fond : photographier les choses m’aide à mieux les regarder. Ça me force de façon presque mécanique, à regarder de manière plus problématisée autour de moi. Parfois c’est un piège. Parfois, parce que mon œil est attiré par quelque chose, je rate complètement ce qui se passait de vraiment intéressant. Il existe quelques grands films précisément là-dessus. Parfois je fais des images parce que je vois déjà la possibilité de cette fiction. J’ai envie de capter quelque chose que je pourrai regarder à nouveau, pour essayer d'en résoudre l'énigme, un peu comme un critique face au film d'un autre, pourrait-on dire. Et à partir du moment où l’on rapproche deux photographies, où on les relie par une sorte de ponctuation invisible, cela produit du récit. Du moins quand c'est réussi : ce qui est intéressant c’est quand la juxtaposition de deux images en produit presque une troisième. C’est ce que j’ai placé au cœur de ce livre qui fonctionne par diptyques, 24 en tout, donc 48 images. Dans un monde idéal chacun de ces diptyques obéirait à une ou plusieurs logiques propres, un régime d’association sans équivalent ailleurs dans le livre. Et, à force de se reformuler, de se réinventer d’une page à l’autre, toutes ces façons de lier ou de faire résonner les images entre elles, tous ces liens invisibles que j’ai tissé à partir de ce que moi je voyais entre deux photographies, va vous permettre à vous qui êtes le spectateur étranger à la fois de ces images et des expériences dont elle ont été prélevées, de voir, d’inventer, de délirer d’autres échos — et c'est à partir de là que la chose va commencer à vraiment m'intéresser.
Cette fin du monde nous aura quand même donné de beaux couchers de soleil : pourquoi ce titre ?
Je suis quasiment parti de là, de ce titre, qui invoquait une idée beaucoup plus ambivalente et moins empreinte de gravité de « la fin du monde » qu’un an plus tard, en pleine crise sanitaire. À un moment donné, j'ai été obligé de me demander s'il était encore possible de réaliser ce projet sous ce titre qui était pourtant le socle sur lequel j’avais édifié les contours et la cohérence de tout le reste. J’avais peur que soudain le sens de l'entreprise paraisse trop immédiatement lisible, voire opportuniste, que la lecture en devienne trop univoque. Il n’y a dans le livre qu’une seule photographie, je crois, dont la prise de vue est postérieure à l’irruption du Covid dans nos vies. Mais s’il y a bien une place à laquelle je ne peux pas me mettre c’est celle d’un spectateur étranger à ces images. Je ne sais pas, a priori, ce que les gens y voient, ce qu'ils projettent d'où elle viennent. Moi je sais où elles ont été prises mais je ne veux pas le dire d'emblée parce que je veux maintenir les choses aussi ouvertes que possibles. Je réponds aux questions qu'on me pose sans faire de mystère, mais je suis rétif à toute forme de légende. Il ne s'agit surtout pas de m’abstraire aux contextes social, politique, géographique spécifiques à ce que je photographie, mais j’essaie toutefois de décaler les images, de les émanciper de l’imaginaire que le lecteur ou spectateur peut attacher à un cadre précis. Si je vous dis d'emblée que ces trois d'hommes qui se tiennent debout, de dos, sont des casseurs de pierre au bord du fleuve Congo, vous allez immédiatement cesser de voir tout ce qui moi m’a a accroché le regard dans cette vision, voire cesser de voir tout court, pour y engouffrer tout ce que vous savez, ou croyez savoir, des carrières de pierre, du Congo, de l’Afrique en général. En l’absence de sujet traditionnel clairement énoncé, d'unité de lieu ou de temporalité circonscrite, la série a vraiment trouvé sa logique dans la forme du livre, et ce principe d’articulation d’images prises sur plusieurs années et dans des endroits très différents les uns des autres. La narration un peu abstraite, un peu mutante que j’y vois et dont je veux croire qu’elle transperce l'ensemble s’est construite sur la base de ce titre qui contenait déjà en lui-même diverses tonalités, interprétations et fictions en germes, d’où l'association le plus souvent d’images assez dépareillées, au risque que la collure paraisse un peu arbitraire, si l’on n’y regarde pas d’assez près.

Entretien réalisé par Lucas Charrier le 19.10.21 à Paris.
Avant de montrer celles qu'il fabrique, Julien Gester a beaucoup écrit sur les images, notamment depuis dix ans dans Libération, dont il est aujourd’hui le correspondant aux États-Unis. Cette fin du monde nous aura quand même donné de beaux couchers de soleil, la série photographique qui constitue son premier livre (Actes Sud, 2021), a fait l’objet de plusieurs expositions – aux Rencontres d’Arles 2022 mais aussi aux murs d’un lavomatic parisien. Elle se montrera à nouveau à la galerie Maupetit, à Marseille, du 27 novembre au 10 janvier.
︎︎︎ juliengester-photo.com
︎︎︎ juliengester-photo.com
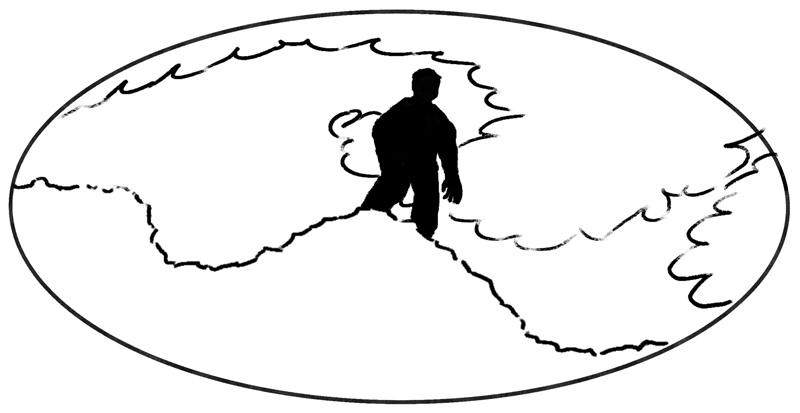
 Comment partagez-vous votre vie entre la pratique de la photographie et de la critique de cinéma ?
Comment partagez-vous votre vie entre la pratique de la photographie et de la critique de cinéma ?