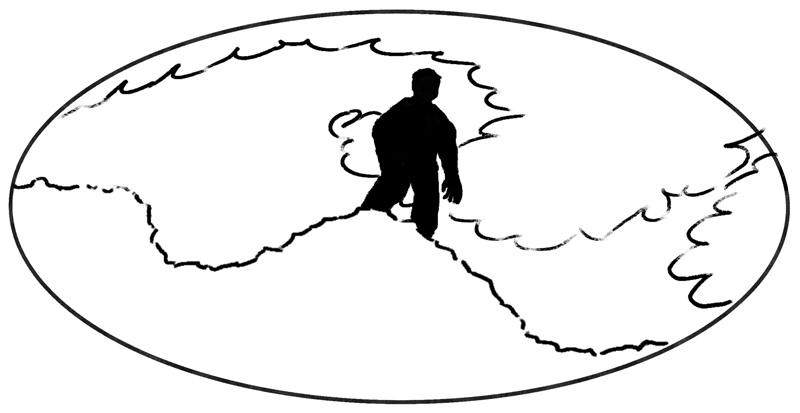Questionnaire
Jules Bourbon





Est-ce que la création en général et le cinéma en particulier est pour vous un moyen de fabriquer des utopies ?
Ce qui m’intéresse se situe plutôt du côté de l’échec, de ce qui balbutie. Dans mon dernier film, mon personnage crée un protocole, un cadre qui provoque des situations souvent fragiles, parfois absurdes. Ces situations explorent une attention accrue au réel, au banal, à ce qui est là, même quand cela n’a pas de sens ou ne mène nulle part. Il ne s’agit pas d’utopies, mais, plutôt de fabriquer à partir du réel, en le déplaçant.
Que raconte votre film de votre rapport au vivant ?
Il est très lié à une attention portée au quotidien, qui, pour moi, fait sujet. Il n’y a dans le film que des matériaux ordinaires : des choses que je note, que je ramasse… Des objets, des traces, des signes, qu’ils soient présents dans la matière même ou produits par le traitement de l’image. C’est à travers ces objets que je distingue quelque chose qui se tient derrière. La langue suit le même mouvement. Le texte avance par détails, par fragments, parfois disloqués. Le film raconte finalement la manière dont je regarde ce qui m’entoure.
Est-ce que vos films ressemblent à vos rêves ?
Ils ne reprennent pas forcément la forme de mes rêves. Mais il y a quand même un langage qui s’en rapproche : sans narration, avec des éléments parfois ultra détaillés, et parfois beaucoup plus flous. Dans mon dernier film, il y a des moments où l’on a une sorte d’hyper-zoom, une vraie mise au point sur des détails : toutes ces photographies de boîtes contenant des post-it ou les repas qui défilent successivement. Et puis, ensuite, on repasse dans quelque chose de beaucoup plus flou. Et ça, je pense que c’est assez proche du rêve, en fait : se rappeler d’un truc très, très pointu, et puis, juste après, se perdre dans quelque chose de beaucoup plus diffus. Aussi, dans la construction du texte, cela fonctionne beaucoup par associations, par images qui surgissent sans que je ne saisisse vraiment d’où elles viennent. Il n’y a pas de fil narratif continu, c’est plutôt des bouts de pensée, faits de détours, de ruptures. Le texte se construit par montage, par déplacements successifs, plus que par enchaînement purement logique.
Quelle place donnez-vous aux fantômes dans votre travail ?
Dans mes films, les personnages se confondent presque avec le fond. Il n’y a pas vraiment quelque chose qui se détache, une figure avec une sorte de décor, et de plan. Tout est un peu confondu et traité au même niveau. Un fantôme c’est aussi un peu ça, il se fond dans son décor, pas seulement en tant que figure déambulante mais plutôt comme reste, trace fantomatique de quelque chose qui a été ou qui n’est plus vraiment. En travaillant les images, en les effaçant, on ne sait plus vraiment si on a le fantôme de quelque chose ou si c’est en train d’apparaitre. Il y a une sorte de présence/non présence.
Que permet une image fixe que ne permet pas une image en mouvement ?
Quand on est confronté à une image en mouvement, le regard est forcément amené, entraîné par une suite consécutive. J’ai l’impression d’être beaucoup plus auteur de la manière dont je peux appréhender l’image quand elle est fixe, parce qu’il n’y a pas de contrainte matérielle liée au temps qui passe pour diriger le regard. Si j’ai envie de m’attarder dans un coin, dans une matière, dans un petit détail, ou même de regarder l’ensemble sans rien regarder précisément, je peux. Alors qu’une image en mouvement me semble d’avantage conduire mon regard. Il y a quelque chose, dans l’image en mouvement, qui, pour moi, peut-être trop proche du réel, ou dire déjà trop de ce qu’elle montre. Alors que dans une image fixe, il y a un potentiel que je peux venir gratter. Avec l’image fixe, on n’est pas dans l’illusion d’un mouvement fluide, on voit bien qu’on est dans quelque chose d’autre. Ce que je regarde le plus, ce sont les textures, le mouvement. Pas le mouvement du personnage, mais le mouvement même d’une forme de matière. Parce que parfois, on pourrait se dire qu’il y a des sortes de mouvements d’outils, de pinceaux, de poils, etc. Et du coup, c’est ça que je regarde. Il y a quelque chose à la surface même des images que je viens travailler.
Ce serait quoi pour vous le décor de cinéma parfait ?
J’écris à partir des lieux que j’habite, dès le moment où je m’y installe. C’est ainsi que je pense pouvoir faire émerger une forme cohérente. Le décor se construit à partir de ce regard : voir ce qui est autour de soi et le détourner.
Comment décririez-vous votre travail en quelques mots ?
La pratique de l’écriture est au centre de mon travail. Elle jaillit par bribes, fragmentée, et se condense dans les notes de mon téléphone avant de devenir un récit, une auto-fiction. Elle se constitue de petits détails soi-disant insignifiants qui, réunis, font écho et dessinent les premiers fils de trames narratives à investir. En creux d’une expérimentation littéraire et plastique du quelconque et de l’ordinaire, du vulgaire ou du commun, mon but est de nous plonger dans un état sensible de « là où il ne se passe rien ».
Décrivez en quelques mots un projet auquel vous rêvez.
Quand j’habitais à Nice, je voulais faire un film dans un hôtel bleu sur la Promenade des Anglais, simplement parce que je passais souvent devant. C’est venu comme ça. Je voyais ce lieu comme quelque chose entre un palais et une piscine municipale. J’aurais voulu m’y installer un certain temps, filmer les couloirs, les allées, les venues. Sans retournement de situation, sans péripétie. Trouver un système. Juste voir ce qui se passe en partant de cette intuition-là. Il y a beaucoup de choses qui relèvent de l’intuition, que je ne remets pas vraiment en question. Par exemple, je commence à accumuler des post-it, et à un moment je me dis : ah, j’ai envie de travailler avec des post-it. Et au fond, tout le principe de la répétition, du travail, c’est simplement d’essayer de comprendre pourquoi j’ai eu envie de faire ça, intuitivement.
Quels sont les films qui vous habitent ?
Dans mon travail filmique, ce sont surtout des formes proches de la photographie, qui m’habitent. J’ai davantage regardé le travail de Miroslav Tichý, Boris Mikhaïlov, Claude Cahun, Alix Cléo Roubaud… que celui de réalisateurs. Mon rapport au cinéma et à l’écriture s’est construit avant tout à travers l’image fixe. J’ai l’impression d’avoir développé une langue visuelle par cette attention/relation aux images. À une époque, j’accumulais des revues, des papiers, des livres, je découpais, je mettais de côté, je constituais des corpus. À force de fréquenter les images, quelque chose s’est formé progressivement.
Quels sont les films qui ont marqué :
Votre enfance :
Peau de cochon - Philippe KaterineRéveils - Pierrick Sorin
Votre adolescence
Elephant - Gus Van Sant
Le Bois dont les rêves sont faits - Claire Simon
Votre vie d’adulte
Shibuya-Tokyo - Tomonari Nishikawa
Wavelength - Michael Snow
Né à Paris en 1994, Jules Bourbon développe une pratique artistique à la croisée du cinéma et de l’art contemporain, mêlant vidéo, photographie et écriture. Diplômé de la Villa Arson puis des Beaux-Arts de Paris, il intègre Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains en 2024. L’écriture occupe une place centrale dans sa démarche. Nourri par le quotidien et le banal, il s’attache à filmer et à raconter ce qui se répète, ce qui s’accumule, ce qui, à première vue, semble insignifiant. Son travail a été présenté dans plusieurs lieux et événements, notamment au Cinéma du Réel au Centre Pompidou, à la Fondation Pernod Ricard et au Salon de Montrouge. En 2022, il reçoit le prix Thaddaeus Ropac. L’année suivante, il est sélectionné pour les Révélations Emerige, avec la galerie Nathalie Obadia comme partenaire de cette édition et reçoit la Mention spéciale du jury de la Villa Noailles.
image : Câine Pierdut
image : Câine Pierdut