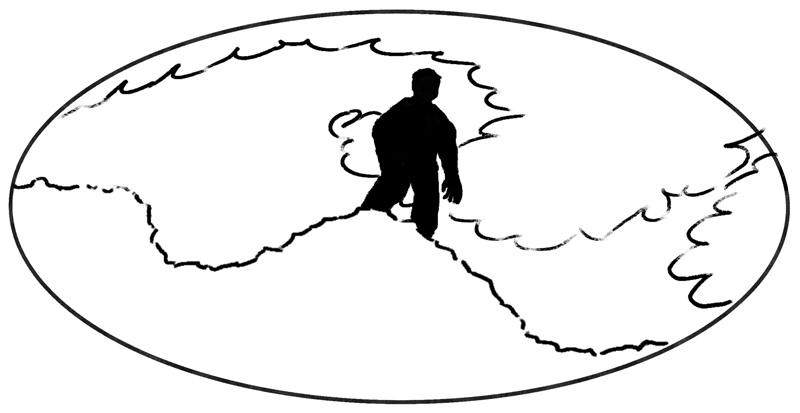L’expérience du plaisir
Ira Sachs

Quelle est l’origine de Passages ?
J’ai écrit un scénario avec Mauricio Zacharias après Frankie et pour la première fois depuis que nous collaborons ça ne fonctionnait pas, je n’avais pas envie de faire le film. C’était un sentiment étrange, assez troublant. Je n’étais pas sûr de ce que je voulais faire, de quelle histoire j’avais envie de raconter. C’était au début de la pandémie. Je crois que ce que je recherchais c’était l’intimité. Je voulais faire un film qui témoigne d’une forme intimité. Je ne voulais pas faire un film sur des idées, sur des thèmes, un film politique sur l’identité… Je voulais faire le genre de film que j’avais envie de voir et qui porterait sur des relations. On a regardé L'Innocent de Luchino Visconti. C’est un film très excitant, aussi bien en termes de narration que d’érotisme. J’étais intéressé par le fait qu’en tant qu’homme gay j’ai pu éprouver du désir pour le corps de Laura Antonelli. La facilité avec laquelle ce désir est advenu m’a surpris. Rien ne semblait figé. C’est ça qui a motivé Passages : l’histoire d’un homme qui vit une vie et qui décide soudain qu’il veut en vivre une autre. Dans le film on ne fait même pas attention à ce moment. C’est dû aux acteurs. Tout change avec les acteurs. Par exemple dans Keep the lights on, sans Thure Lindhardt le film aurait le potentiel de parler de passivité. Mais parce que c’est lui c’est un film sur l’action. Passages pourrait être un film sur un homme qui fait le choix de bousculer son désir. Mais parce que le personnage est interprété par Franz Rogowski ce n’est pas le sujet, ce n’est pas ce que raconte le film.
Que voulez-vous dire quand vous dites ne pas avoir voulu faire un film sur des idées ?
J’ai écrit un scénario, il y a donc des idées, mais je voulais faire un film plus simple dans ses intentions.
Plus simple par rapport à quoi ?
Au cinéma américain contemporain. Je pense avoir fait un film en réponse au cinéma américain même si je l’ai tourné en France. J’ai l’impression que certains films n’existent que par la domination d’intentions sous-jacentes, qu’il y a une forme d’injonction à la sur-intentionnalité des récits. Je n’étais pas sûr de pouvoir refaire des films un jour et cette pression m’a libéré, m’a permis de faire un cinéma, le mien, dont je pensais qu’il n’existerait plus jamais. Je ne suis toujours pas sûr qu’il existera encore dans quelques années. Je pense à chacun de mes nouveaux films comme au dernier. Je n’ai rien à perdre, autant prendre des risques. Le film est né d’une grande liberté, qui s’est aussi nourrie des trois acteurs avec lesquels j’ai travaillé. Nous avons créé un environnement de liberté et de confiance.
Pouvez-vous préciser ce que vous dites sur les idées et les intentions du film ?
Disons que je voulais essayer de ne pas avoir de route toute tracée, de ne pas avoir une mission, de croire que l’intimité elle-même pouvait être le sujet de l’histoire. Maintenant les gens vont parler du film comme une série d’idées. Mais en le faisant je voulais faire un film qui parlait du fait d’être vivant avec les autres. Quand j’ai fait le film, j’avais la sensation que ça n’intéresserait personne. Mais ça m’était égal.
Le film n’essaie pas de nous dire quelque chose, de nous convaincre de quoi que ce soit, c’est très agréable.
La vérité c’est qu’en tant que réalisateur même si vous créez ce sentiment, votre travail c’est malgré tout de faire en sorte que les gens se sentent portés. On crée une sensation de liberté mais c’est une sensation fabriquée. Sinon on perd la confiance. Le public a besoin de croire qu’une histoire est en train d’être racontée même s’ils ne savent pas exactement où elle mène.
Comment on garde le cap de cette ambition ?
La stratégie c’est de créer des évènements sur le tournage qui ne peuvent exister que dans ce présent. Chaque scène est un éventent et mon travail c’est de créer la possibilité pour que cet évènement ait de l’épaisseur, soit contradictoire, imparfait… C’est une stratégie purement héritée du cinéma de Pialat. Les films de Pialat sont une série d’évènements dans le temps qui, par le processus du scénario et du montage deviennent une histoire. Mais vous avez l’impression que l’histoire pourrait emprunter n’importe quelle direction à tout moment. Chaque moment a ses possibilités. Je fais tout ce que je peux pour créer un maximum de possibilités dans un moment. Par exemple je ne discute pas avec mes acteurs des envies de leurs personnages, je ne parle pas d’intentions ou de sous-textes. Sinon j’aurais l’impression d’empêcher ces choses, de leur imposer des limites.
C’est une méthode spécifique à ce film ?
Ce qui est spécifique à ce film c’est qu’il n’y a pas de passé. Il n’y a aucune conversation sur le passé. Il n’y a pas d’histoires qui surgissent du passé. On n’en raconte pas. Les personnages vivent dans l’instant présent. Par exemple, on avait écrit une scène qui ne fonctionnait pas. C’est parce que précisément dans cette scène les personnages faisaient référence à leurs histoires passées. Je voulais être dans le présent au maximum.
Et dans le mouvement.
Oui. Je reviens de Sundance où j’étais invité à conseiller des jeunes cinéastes. C’était intéressant, ça permet de comprendre aussi des choses sur soi et sur sa propre créativité. Pour moi le jeu c’est de l’action, donc réaliser c’est créer de l’action. Je pense que la réalisation est une forme de psychanalyse et que le réalisateur est l’analyste. Un analyste doit laisser de la place au silence, à l’ambivalence, à ce qui n’est pas articulé. C’est ce que j’essaie de créer sur un plateau, la possibilité pour l’inarticulé d’apparaître.
Qu’y a t-il de très américain et de très français dans ce film selon vous ?
Je ne voulais pas faire un film français mais j’ai pris du plaisir à vivre dans l’intimité d’un cinéma français que j’admire. Je n’ai pas résisté aux éventuelles associations qu’on pourrait faire entre mon film et le cinéma français, aux allusions qu’on pourrait trouver dans Passages. La couleur rouge dans ce film c’est Sandrine Bonnaire. Je ne peux pas vous dire à quel point Sandrine Bonnaire signifiait pour nous sur ce film. Elle, encore plus que Pialat, était un guide. Elle est si incroyable. Disons que c’est cette cinéphilie qui a participé à la fabrication du film. James Cagney aussi était très important pour moi. Ses personnages font des choses horribles de la plus belle des manières.
Votre cinéma est bien plus visuel qu’on ne le dit, c’est en tout cas par cette porte que j’y suis entré, séduit très tôt par la beauté des images, des lumières, du grain de la pellicule, de la douceur du numérique… À quel point votre processus est-il visuel ?
Même si je travaille beaucoup avec mes acteurs pendant la pré-production, je travaille encore plus avec mon chef opérateur. Je fais toujours un storyboard. Je dois arriver sur un plateau en sachant précisément comment je vais filmer telle ou telle scène. Je peux changer d’avis mais j’ai besoin de trouver le langage avant. C’est un travail assez rigoureux. Ce n’est pas intellectuel mais ce qui m’intéresse c’est de comprendre comment les personnages existent dans l’espace. J’essaie de décider comment la caméra va intégrer les personnages dans leur environnement. On s’est vraiment bien trouvés avec la directrice de la photographie Josée Deshaiessur ce film. On se disait : l’image est une boîte pas un rectangle. On devrait toujours sentir qu’il y a quelque chose en dehors du cadre, dont on est conscient mais qu’on ne voit pas forcément. Tout cela revient à faire des choix d’angles de prise de vue et d’objectifs. Il y a une continuité dans le tournage à ce processus de préparation. J’aime chercher des images qui vont donner l’impression qu’il se passe des choses tout autour, sur les bords, au-dessus, en dessous… Le montage fonctionne comme ça aussi pour moi. C’est une série d’entre-deux. On doit croire qu’il s’est passé quelque chose avant et qu’il se passera quelque chose après.
Qu’aviez-vous vu du travail de Josée Deshaies qui vous a donné envie de travailler avec elle ?
J’avais vu Avant que j'oublie de Jacques Nolot et Saint-Laurent de Bertrand Bonello. Son sens de l’espace et de la lumière est incroyable. C’est comme avec Mauricio Zacharias, on parle le même langage. On a la capacité dans notre collaboration à ne faire qu’un. D’ailleurs Je, tu, il, elle de Chantal Akerman, Taxi zum Klo de Frank Ripploh et Avant que j'oublie sont des films très importants pour moi et je me suis rendu compte plus tard qu’ils avaient tous en commun de mettre en scène le réalisateur du film. Je ne fais pas ça mais je pense que je suis ému par la transparence de ce genre de films, qui fait que le réalisateur est son film, il l’incarne à tous les niveaux.
Vous avez fait des films plus ou moins autobiographiques, c’est aussi une forme de transparence.
Je pense qu’il y a un lien entre Keep the lights on et Passages. Le premier est très autobiographique mais pas le second. Mais je ne pense pas que l’un soit plus transparent que l’autre. Je viens de revoir Keep the lights on pour la première fois depuis dix ans. C’était dur à regarder… mais c’est positif ! The Delta aussi était très autobiographique. Ça vous replonge dans des moments qui ne sont pas très plaisants…
Keep the lights on et Passages semblent très liés. Il y a une vraie douceur dans les deux films, en même temps qu’une véritable violence dans les rapports humains et la dureté des relations. Quelque chose d’à la fois très tendre et très brut.
Disons que je sais que le conflit c’est le drame et le drame c’est du plaisir. Il doit y avoir du conflit, de la tension, du risque pour que les scènes fonctionnent. Le point commun à ces deux choses que vous décrivez c’est qu’elles donnent toutes les deux du plaisir ce qui est sans doute ma plus grande intention en tant que cinéaste : l’expérience du plaisir. Mais c’est un mot compliqué. Il peut venir de l’intérieur, d’un savoir, d’une émotion érotique qui est très importante pour moi particulièrement dans ce film. L’eros d’une image… Je dirais que Keep the lights on, Love is Strange et Little Men sont une trilogie sur des relations masculines à différents âges. C’est comme ça qu’ils ont été pensés. Passages fait en effet écho à des thématiques que j’abordais dans Keep the lights on c’est vrai mais il est surtout très lié à mes deux premiers films. Je suis retourné à une forme de cinéma d’observation assez instinctif, et une plus grande acceptation de l’aspect Queer de mon cinéma. J’avais envie que l’image soit Queer, pas seulement l’histoire. J’avais envie de prendre du plaisir à construire des images de corps et d’ébats sexuels.
Parlons un peu d’écriture pour finir, ou en tout cas de la structure du film qui est assez répétitive. Les personnages font beaucoup d’allers-retours d’un appartement à l’autre.
Même si en surface le film se répète, il y a dans le scénario une attention assez rigoureuse au suspense et aux évolutions narratives. Chaque scène est différente de la précédente. Les relations changent sans cesse même si les lieux restent les mêmes. C’est intéressant de voir le film en ayant en tête L’innocent de Visconti. Passages est une histoire d’amour mais après 15mn les relations sont toutes dans un état déplorable. On atteint un espèce de climax émotionnel très tôt dans le film et la suite revient, pour les personnages, à se mettre en quête d’un objectif qu’ils vont pourchasser tout le long. Cette idée qu’il faut atteindre quelque chose est essentielle dans l’écriture. Que veulent les personnages ? Scène après scène quelque chose leur manque. C’est ce qui maintient votre attention. Vous ne revivez pas le même moment, chaque moment est différent car l’enjeu n’est plus le même.
Entretien réalisé par Lucas Charrier le 20 Juin 2023 à Paris.
Ira Sachs est un réalisateur américain né en 1965 à Memphis. Il est notamment connu pour ses films Keep the Lights On, Love Is Strange, Brooklyn Village (Little Men) et Frankie avec Isabelle Huppert (présenté au Festival de Cannes en compétition).
︎︎︎ filmographie