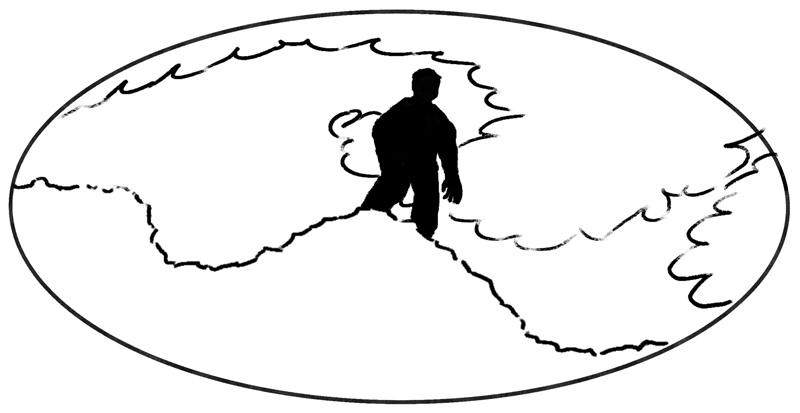La juste distance
Denis Lenoir




Quel terme vous convient le mieux : directeur de la photographie, chef opérateur ou cinematographer ?
Cinematographer. Je vis et travaille aux États-Unis donc ça me parle plus. Je trouve que ça correspond beaucoup plus à ce qu’on fait. Directeur de la photographie c’est pertinent si on ne fait pas le cadre et si on a une équipe conséquente. Dans le chef opérateur, le mot « chef » ne me plaît pas beaucoup et je ne suis pas simplement opérateur. Il y en a un que j’aime bien aussi, c’est lighting cameraman. Quand j’ai commencé, quand je ne travaillais pas encore dans la fiction, ça correspondait assez à ce que je faisais, dans les films d’entreprise par exemple : je faisais la caméra et j’éclairais. Mais cinematographer ça correspond mieux, surtout depuis quelques années, parce que ça a été un métier très technique qui demandait beaucoup d’expérience et de connaissances, mais doucement, progressivement ça a complètement changé, et pas seulement avec l’arrivée du numérique, avant déjà. Maintenant on est plus en train de raconter des histoires que d’éclairer. On éclaire un peu, mais de moins en moins. Du coup, ce qui fait notre qualité, c’est ce qu’on apporte au metteur en scène. Plus que la beauté intrinsèque de ce qu’on fait, qui maintenant n’intéresse plus grand monde. Ce n’est pas parce que je fais la plus belle photo du monde que je travaille encore un peu malgré mon âge avancé, je ne fais pas la plus belle photo du monde. Il y en a de renversantes, mais ce n’est pas mon créneau. Je ne sais pas si c’est ce que je sais faire ou ce que j’aurais envie de faire. Mais on doit trouver que j’aide bien à raconter les histoires.
Comment définiriez-vous votre travail ?
Quand j’étais jeune chef opérateur, j’avais deux modèles, ou en tout cas deux pôles vers lesquels j’étais attiré : Storaro et Nykvist. Storaro c’était renversant. Il avait 24 ans quand il a travaillé sur Le Conformiste, c’était son premier film. C’est extraordinaire, ça reste une des plus belles photos du monde. Et Nykvist on s’en souvient pour son travail avec Bergman, son approche des actrices… J’idolâtrais Storaro, tout en ayant peu de sympathie pour lui, mais je savais déjà que ma veine à moi, ce pour quoi j’étais fait, ce n’était pas d’être Storaro, mais de m’inscrire dans une veine proche de celle de Nykvist.
Pensez-vous que les images que vous faites correspondent à votre personnalité ?
Oui, au moins indirectement. Je ne suis pas sûr que ma personnalité se transmette dans mes images parce que je ne choisis ni le scénario, ni le décor, ni les acteurs, les costumes, le maquillage ou même l’heure à laquelle on tourne. Donc de ce qu’on voit sur l’écran à l’arrivée je n’ai pas fait grand-chose. En revanche si ça me correspond quand même c’est par l’intermédiaire du réalisateur qui m’a choisi et s’il m’a choisi c’est qu’il estime que je suis un peu de sa famille de pensée et donc qu’il est aussi un peu de la mienne. Il y a forcément une espèce de réciprocité là-dedans.
Pensez-vous avoir un style ? Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez ?
Je me suis posé la question évidemment, comme tout le monde. Ma première réponse était de dire que je n’en étais pas conscient. Il doit y avoir des choses que je fais, mais sans le savoir. Et je ne veux surtout pas qu’on me le dise parce que je n’ai pas envie de me répéter consciemment, ou au contraire de me démarquer de ce que je viens de faire en me forçant à en prendre le contre-pied. Je préfère garder une forme d’innocence. On m’a dit que j’avais un goût pour les fonds surexposés. C’est possible, mais on pourrait trouver beaucoup de contre-exemples. C’est vrai que je n’ai pas peur de la surexposition, ou de la couleur verte par exemple. Mais ça ne fait pas un style. Je me suis glorifié un temps de faire une photo différente à chaque film. C’était naïf. J’ai fini par réaliser que la photo ne tenait pas de moi et que donc qu’elle soit différente ne tenait pas à moi, ça tenait au genre du film, à l’époque… Je dis ça aussi avec un certain goût de la provocation pour embêter mes collègues : le chef opérateur est co-responsable de l’image, son travail a une importance, mais à la marge. Ce que je fais sur Un Beau Matin n’a rien à voir avec ce qu’on a fait sur Bergman Island. Ou plutôt moi j’ai fait quasi la même chose, mais c’est ce que je filmais qui était différent. On tourne à Paris et pas à Farö, avec certains acteurs, qui parlent français… Ce sont deux films et deux photos différentes. Ce n’est pas pour me flageller, mais il s’agit de remettre les choses à leur place. J’ai travaillé en 1973 sur un long-métrage qui s’appelait Les Autres d’Hugo Santiago avec Ricardo Aronovich comme chef opérateur. À l’époque la pellicule faisait 100 ASA (mesure de sensibilité d’une pellicule à la lumière, ndr), voire peut-être moins. Les optiques n’ouvraient qu’à 2,5 et de toute façon Ricardo aimait travailler à 4,5. Il n’y avait pas de retour vidéo. Après chaque prise tout le monde se tournait vers le cadreur pour demander comment c’était. La lumière que faisait Ricardo, on ne la voyait pas ! C’était un tapis de lumière. Il éclairait tout, même les ombres ! Donc un œil normal, le mien, ceux de toute l’équipe, voyait de la lumière partout, un tapis de lumière. Et le lendemain aux rushes, ça devenait du clair-obscur. Parce qu’il y avait 5 valeurs de diaphragme de différence entre ce qui était éclairé, très éclairé et encore plus éclairé. Il y avait une vraie magie puisque personne ne savait comment l’image allait sortir. Depuis Jerry Lewis a inventé le retour vidéo, les pellicules sont devenues plus sensibles, les optiques se sont mises à ouvrir plus… On a commencé à voir des images en direct sur le plateau qui ressemblaient un peu à ce qu’on faisait, et donc on savait à peu près ce qu’on était en train de faire. Aujourd’hui ce qu’on voit sur un bon moniteur c’est exactement ce qu’on est en train de faire. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne va pas tout retravailler ensuite. Mais c’est devenu beaucoup plus facile d’être un excellent chef opérateur. Du coup le métier se dévalorise, ce qui est normal, puisque si le métier est plus facile, plus de gens peuvent le faire et donc c’est moins bien respecté et moins bien payé. Il ne s’agit pas de s’en attrister ou de s’en réjouir. Ce qui continue quand même de faire la valeur de certains d’entre nous c’est la relation au réalisateur qui est différente à chaque fois et qui, on espère, apporte beaucoup au réalisateur. On donne confiance, on encourage, on pousse, on calme… Mais ça a peu à voir avec la prise de vue ou l’éclairage.
Comment s’est passée votre rencontre avec Mia Hansen-Løve ?
Je l’ai connue jeune actrice sur Fin août, début septembre d’Olivier Assayas. Je suis un ami d’Olivier donc quelques années plus tard j’ai côtoyé Mia socialement avant même qu’elle ne commence à réaliser. Puis elle s’est mise à faire ses films que j’ai admirés et je lui ai dit. Elle a travaillé sur ses deux premiers films avec Pascal Auffray, ensuite avec Stéphane Fontaine sur Un Amour de Jeunesse. Puis elle m’a demandé, j’étais ravi et on a fait Eden !
La collaboration a tout de suite été très fluide ?
Oui je crois. Mais il faudrait plutôt lui demander à elle. Mon rôle c’est surtout de deviner ce dont à besoin un cinéaste et d’essayer de lui apporter. Mais ce n’est pas à moi de dire si je suis satisfait de la collaboration. Mais on a quand même des tas de choses en commun. En étant méchant, on pourrait parler de bon goût. En étant gentil, ce serait un goût pour la touche légère, une aversion pour les effets dans la figure, une certaine forme de modestie dans le récit, un souci du naturel, de la vraisemblance et surtout de la légèreté. On ne peint pas au rouleau !
Quel regard portez-vous sur les films que vous avez fait avec elle parmi le reste de votre filmographie ?
Bergman Island est un de mes films préférés comme produit fini, sans parler de mon travail… Je pense que c’est un très très grand film pour dire la vérité. Un instant classic comme on dit en anglais. Ce qui ne veut pas dire que je n’aime pas L’Avenir ou Eden, j’adore L’Avenir et j’aime encore plus Eden. J’ai une faiblesse pour ce dernier. Mais Bergman Island est un des tournages où j’ai été le plus heureux de ma vie. J’ai surtout une admiration sans borne pour Mia, il faut dire les choses. Elle le sait, je lui dis de temps en temps, mais comme elle n’aime pas qu’on lui dise ce genre de choses, elle m’arrête. Mais c’est la vérité pure et simple, je pense que c’est une très grande réalisatrice.
Les films de Mia Hansen-Løve sont dans la vie, ils sont en mouvement. Comment trouvez-vous l’équilibre entre fictif et mobilité ? Deux images-clés incarnent cette idée et son cinéma tout entier : l’image récurrente d’une femme endormie, et celle de personnages qui se baignent, qui sont dans l’eau, qui font corps avec un élément en perpétuel mouvement.
On n’a pas vraiment de conversations générales comme ça. Je vois vraiment son cinéma comme un cinéma mobile. J’ai l’impression que la caméra bouge tout le temps, ce que j’adore. On partage elle et moi un goût pour une caméra qui ne bouge pas seule. Si un personnage est assis sur une chaise, on s’interdit de bouger la caméra et on a tendance à ne la bouger que si l’acteur lui-même se déplace. Il y a peu de mouvements gratuits. Du coup si une femme dort, on ne va pas bouger la caméra. Je vois ça de façon très pragmatique. Mais je n’ai jamais beaucoup conceptualisé les choses. Je suis d’ailleurs assez nul en préparation, ça m’ennuie. Il m’est arrivé de passer des heures autour d’une table avec un réalisateur et de lutter contre le sommeil. Je pense qu’une scène peut être découpée de centaines de façons différentes. Mia commence par faire son découpage sans moi. Quand j’interviens, le découpage existe déjà, et elle a déjà joué les scènes avec Clémentine Schaeffer la scripte, toutes les deux faisant tous les rôles et se photographiant à l’iPhone. Elles dessinent scène par scène les décors vus du ciel avec des triangles qui indiquent les angles de caméra, des pointillés pour les travellings, les déplacements des acteurs… Ce qu’on appelle le blocking en anglais. C’est à mon sens plus important que le découpage, qui n’intervient que plus tard, sauf à inventer des plans très sophistiqués complètement conçus. Je pense à un exemple, un plan dans Carrington de Christopher Hampton qui faisait alors son premier film. Ce n’était pas quelqu’un de visuel j’ai donc quasiment découpé son film moi-même, ce qui n’est pas un problème. Mais le plus beau plan du film c’est ce plan qui se passe la nuit qui commence sur une maison de campagne et finit sur Carrington seul dans le jardin. C’est Christopher qui a conçu ce plan de manière totalement abstraite. Mais c’est rare. C’est le cas pour les plans à la grue en général. Je pense que tous les réalisateurs, même ceux qui ne sont pas visuels ont pour chaque film deux ou trois images très fortes et c’est à moi de les aider à les exécuter.
Comment fait-on pour garder le cap d’un film, une fluidité, sur un tournage très découpé qui avance sur plusieurs mois de façon intermittente, comme sur Un Beau Matin qui se passe sur plusieurs saisons ?
C’est l’exigence de Mia. Je suis moi-même relativement exigeant, mais à côté d’elle ce n’est rien ! Mia s’entoure de gens qui l’aiment et qui l’admirent donc évidemment on se bat pour elle, mais au final c’est toujours l’artiste qui est le plus exigeant. Il m’arrive de me satisfaire de plans quand Mia va elle vouloir plus et mieux. Elle ne cède pas. Elle ne crie jamais, ne s’énerve contre personne, mais elle est inflexible. Je ne l’ai jamais vue céder.
Et est-ce que c’est plus difficile de maintenir ce cap lorsqu’il s’agit d’un film qui puise dans une matière aussi triviale que celle qui fait notre quotidien ?
Disons que le souci et l’exigence de naturel font qu’on ne peut pas proposer des solutions de rechange lorsqu’on est face à un problème. Alors que par exemple sur un gros film américain on va pouvoir remplacer l’effet spectaculaire par une autre idée spectaculaire qui sera tout aussi bien voire mieux. Mais ce n’est pas spécialement difficile pour nous. Il s’agit juste pour Mia de ne pas céder. Moi je peux la rassurer, mais disons que c’est plus le premier cercle qui va intervenir, Marie Doller, la première assistante mise en scène et Clémentine Schaeffer. On s’entend vraiment bien, on est amis, mais je ne fais pas partie de son cercle intime. Elle sait qu’elle peut compter sur moi, mais après les prises elle va plutôt en discuter avec elles.
Est-ce qu’il peut vous arriver d’être frustré par la forme de modestie qui semble régir tous les choix d’images, d’avoir envie de vous appesantir un peu plus sur certains détails, de belles lumières par exemple ?
Dans Bergman Island, il y a un plan dont je me suis dit que c’était le plus beau plan que j’ai fait de ma carrière, et il se trouve qu’il est à moitié coupé au montage. C’est à la fête du mariage. On commence sur Anders Danielsen Lie en train de danser, puis on découvre Mia Wasikowska qui regarde les danseurs, elle se retourne, elle s’éloigne de la piste de danse, on voit une maison dans le fond et un feu, un joli ciel de crépuscule, et là le plan se coupe alors qu’on la voyait descendre vers un autre feu avec un lac et un ciel encore lisible qui s’y reflétait, c’était magique ! Un plan d’anthologie. Mais elle l’a raccourci. Toujours dans Bergman Island, il y a un plan de Mia Wasikowska sur une route à bicyclette. Mais Mia m’a demandé de panoter légèrement, ce que je ne comprenais pas. Elle trouvait ça trop « carte postale ». Elle cherchait un peu d’imperfection. Dans le même ordre d’idée, et c’est là où je la trouve parfois un peu dogmatique, sur Un Beau Matin dans l’appartement, on a tourné sur plusieurs saisons. Donc dans mon éclairage j’essaie de faire sentir le temps qu’il fait à l’extérieur. J’ai fait un faux effet de soleil qui heurte le pas d’une porte. Elle l’a vu et me l’a fait enlever parce que ce n’était pas naturel. Ce qui est rigolo c’est que quelques semaines plus tard elle m’a soupçonné d’avoir recréé le même effet sur un autre plan alors que c’était le vrai soleil.
Par peur que ça fasse trop « effet de cinéma » ?
C’est ça.
Vous aimez jouer avec les imperfections, accepter de ne pas tout maîtriser ?
Pour faire rire mon équipe, je leur explique que ma devise sur un plateau de tournage c’est « vite et mal ». C’est une blague, mais je dis ça pour faire passer un message, qui est que le temps compte énormément et que je ne veux pas le gaspiller. Les imperfections ne me font pas peur. Jon Avnet, avec qui j’ai pas mal travaillé, disait qu’une de mes forces c’est de savoir avec quoi « I can get away with ».
Je trouve les films de Mia Hansen-Løve bien plus beaux qu’on ne le dit, je trouve qu’on ne leur rend pas suffisamment justice sur le plan formel. Maya, Bergman Island et Un Beau Matin comptent parmi les plus beaux films que j’ai vu dans ma vie, d’un point de vue strictement visuel, mais pas seulement d’ailleurs. Est-ce qu’il y a des choses dans sa façon de faire des images qui sont plus risquées qu’elles n’y paraissent ?
Je n’ai pas l’impression qu’on se lance dans des choses périlleuses, mais en revanche c’est vrai que ce qu’on fait est beaucoup plus difficile que ça n’a l’air. Il y a des choses qui sont quasi virtuoses à essayer d’exécuter correctement et à l’arrivée quand c’est réussi, ça semble de la plus grande simplicité. C’est plutôt l’exécution qui est difficile, pas le risque du résultat. Mais pour que ça marche, c’est essentiel qu’on ne voit pas le travail.
Les quatre films que vous avez fait avec elle ont chacun leur identité propre. Est-ce que pour Eden le challenge était de trouver une forme qui tienne sur la durée, qui supporte les années qui passent dans le film ? Et est-ce qu’un autre challenge sur ce film n’était pas de tourner en numérique ?
Pour moi le numérique n’était pas un challenge, mais le film oui. Pour Mia à l’inverse, elle voulait tourner en pellicule, mais elle n’a pas eu le choix. Sur la forme et le passage du temps, je ne me sens pas vraiment concerné. J’ai déjà fait ça de façon subliminale sur d’autres films dont je suis assez fier. Sur Carrington, par exemple. Le film se passe sur vingt ans, il est découpé par chapitres. À chaque chapitre j’ai flashé la pellicule, beaucoup au premier, un peu moins au second et ainsi de suite jusqu’à la fin du film où elle ne l’est plus du tout. Personne ne l’a jamais remarqué. Mais moi je sais que quand on prend le début et la fin c’est comme deux films différents. Comme c’est progressif, ça ne se voit pas, et ça me plaît beaucoup pour cette raison-là. Sur Bergman Island il y a un film et un film dans le film. En lisant le scénario, je cherchais des idées, je me voyais déjà en tourner un en pellicule et l’autre en numérique, un avec une pellicule normale, l’autre avec une pellicule poussée… bref, il y avait un boulevard de possibilités qui s’offrait à nous ! Mais Mia voulait que les deux parties soient identiques. J’étais déçu, mais ça m’a paru immédiatement plus intéressant que les deux parties s’imbriquent et créent une confusion. Une fois encore, elle avait raison !
Est-ce que la musique a pu vous aider à trouver le ton de vos images sur le tournage d’Eden ?
Oui sûrement, quand on filmait en direct avec la musique, ne serait-ce que l’énergie que ça me donne. Un des grands moments de ma vie de chef opérateur, c’est sur Paris s’éveille d’Olivier Assayas où j’ai filmé Judith Godrèche danser sur une chanson des Pixies, Debaser je crois. Je ne dansais pas et je n’essayais pas de faire danser la caméra, mais c’était jouissif à faire. Je ne suis pas athlète et je ne suis pas très bien coordonné, j’ai une drôle de démarche, je ne me meus pas de façon élégante, mais Avnet dit qu’en revanche quand il me voit avec la caméra à l’épaule c’est comme si je dansais. J’ai autre chose en tête à ce moment-là, je n’essaie pas d’être élégant, je ne suis pas conscient de ça, mais il y a un vrai plaisir pour moi à filmer à l’épaule. J’en ai fait beaucoup sur la série Irma Vep. J’adore ça.
Filmer les lieux est essentiel pour Mia Hansen-Løve. Ça l’est tout autant pour vous ?
On parle assez peu de choses comme ça. Quand on a fait du repérage avec Mia et Marie je regarde ma boussole et je dis à quelle heure de la journée ce serait bien de travailler et Marie, dans la mesure du possible, essaie de respecter ce souhait. Sur Bergman Island on a pu le faire. Mais Mia ne va pas limiter sa mise en scène à cause de la position du soleil.
Mais vous avez l’impression de suffisamment regarder les lieux dans ses films ?
Oui. On fait peu ou pas d’establishing shot, contrairement aux États-Unis où dans la grammaire de la fiction c’est considéré comme indispensable. C’est sans doute hérité de la télévision et des pauses de publicités. Mia ne fait pas partie de cette culture-là, comme la plupart des réalisateurs français, mais c’est vrai qu’il y a chez elle ce désir de montrer où on est.
Sur L’Avenir, après avoir beaucoup filmé aux États-Unis, avez-vous l’impression de filmer la France différemment ou ce ne sont pas des questions que vous vous posez ?
Je ne me pose pas cette question. Je me pose assez peu de questions. Quand on est dans un décor avec Mia, en intérieur par exemple, il y aura pour moi comme pour elle une distance qui est juste, d’instinct.
Est-ce qu’il vous arrive d’échanger sur des références en commun ?
Assez peu parce que j’ai beau avoir une bonne culture cinématographique, elle reste assez datée. Ce sont des films que j’ai vus il y a cinquante ans ou plus et je vois assez peu de films contemporains. Donc je me retrouve avec des réalisateurs qui me parlent de films que je n’ai pas vus. Les Américains aiment beaucoup travailler à partir de références. Quand j’ai tourné Carlos avec Assayas, Yorrick Le Seaux m’a demandé de faire la moitié de la série, c’était en pellicule. On a choisi le type de pellicule et le filtre diffuseur et c’est tout. Je n’ai jamais regardé ses rushes et à l’arrivée personne ne peut dire qui de nous deux a filmé quoi. Sans se consulter. Ce qui ne signifie pas qu’on est interchangeables. On a refait ça sur Wasp Network, j’ai tourné 7 des 21 semaines d’Irma Vep et c’est pareil. Parce que la photo c’est les acteurs dans le décor et c’est le réalisateur qui fait son découpage. Moi je l’exécute. J’influe dessus, mais à la marge. C’est vrai que je filme plus à l’épaule que Yorrick parce qu’il est plus grand et qu’il utilise le Ronin sinon tout serait en plongée. Il y a des différences si on cherche bien, mais loin d’être évidentes. Avec Assayas aussi, on parle peu. Sur Irma Vep il y a différents LUTS parce qu’il y a là aussi un film dans le film. Mais c’était des LUTS conçus avant, ça n’intervient pas vraiment au tournage, ça venait se plaquer sur qu’on faisait. Moi je suis un opportuniste quand je filme un décor. Je ne peux pas empêcher le soleil de rentrer, et je n’ai pas les moyens de faire un faux soleil. Je me sers du décor comme il est, utilisant les dessus des meubles de cuisine pour poser des projecteurs, entrouvrant des portes pour justifier une entrée de lumière. C’est un peu la même chose à l’étalonnage, il ne faut pas aller contre le matériel qu’on a, du coup il faut parfois renoncer à ce qu’on avait en tête et au contraire magnifier ce qui a été capté.
Avez-vous parfois envie de vous libérer des contraintes de la technique, de la lourdeur de l’équipement, simplement pour filmer et faire du documentaire par exemple ?
Me débarrasser de tout ça, oui, mais pas pour faire du documentaire. J’ai besoin d’un réalisateur. Je travaille par ailleurs sur quelques projets photographiques, mais c’est encore autre chose. J’ai besoin de travailler pour quelqu’un. Je n’ai pas l’énergie ni le désir. J’ai eu des velléités de mise en scène au début. J’avais eu une avance de recette pour un scénario. Mais il me manquait le désir. Pour être réalisateur, il faut être obsédé par ça, il faut y penser tous les jours au réveil, essayer de faire avancer son projet, se battre au quotidien… Si on n’a pas ça, ce n’est pas la peine d’y penser. Ce qui n’était pas triste pour moi, une fois admis que je n’avais pas le désir nécessaire, y renoncer fut facile.
Et vous avez un rapport apaisé à la technique ?
Oui. Je suis à la fois suffisamment curieux pour apprendre ce dont j’ai besoin et pas obsédé par la technique. Donc je trouve une espèce de juste milieu. J’ai assez de technique pour être relativement décomplexé par rapport à ça. Bien qu’ayant fait une école de cinéma, je me considère comme un autodidacte. Je ne voulais pas être opérateur donc je n’ai rien appris. J’ai été assistant de deux très bons chefs opérateurs mais je ne regardais pas comment ils travaillaient, ça ne m’intéressait pas. Je suis arrivé au cinéma par la cinéphilie et j’étais déjà passionné par le filmage. Avant même d’imaginer que je travaillerais un jour dans le cinéma, je m’extasiais devant un plan de Samuel Fuller, plus que le scénario, le jeu des acteurs…
Entretien réalisé par Lucas Charrier le 13.01.22 à Paris.
Denis Lenoir est un direcetur de la photographie français né en février 1949 à Paris. Il est diplômé en histoire de l'art de l'École du Louvre, il a étudié la médecine pendant deux ans, il a enseigné l'anglais et s’est formé à l'École nationale supérieure Louis-Lumière. Il a travaillé entre autres avec Mia Hansen-Løve, Olivier Assayas, Bertrand Tavernier, Christian Vincent, Christopher Hampton, Valérie Lemercier, Philippe Claudel et Alexander Payne.
︎︎︎ filmographie
︎︎︎ filmographie