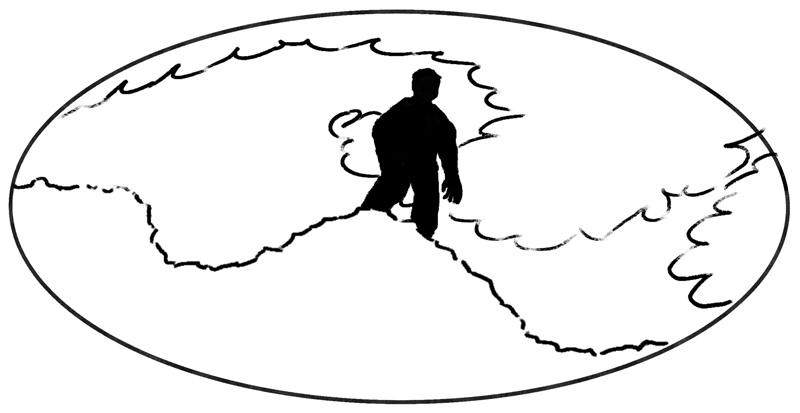Essayer d’être là
Bas Devos et Clément Pérot


Clément Pérot Plusieurs choses m’ont frappé dans ton film et trouvent un écho dans ma pratique. Il y a dans Here un très fort ancrage dans un environnement et en même temps deux individus déracinés, arrachés. L’un s’apprête à partir, l’autre fait partie d’une génération qui commence à s’ancrer. Ils établissent chacun des manières très différentes d’être au monde, aux choses et aux autres. Il y a également cette porosité entre les espaces, la ville et la nature et une manière de filmer l’infime qui appelle à la douceur et à la tendresse.
Bas Devos C’est quelque chose qui m’a toujours fortement intéressé, les effets que peuvent avoir les lieux sur des êtres et vice-versa. Dans mes premiers films je montrais souvent des espaces vides. Pour moi c’était toujours une belle manière de parler des gens qui y habitaient sans être obligé de les montrer, de leur donner de la place. C’est quelque chose qui me manque dans les films. On est des êtres humains et c’est normal d’avoir envie de comprendre l’humain mais cette position d’exceptionnalisme me dérange. Je cherche une manière de travailler plus horizontale qui mettrait toutes les caractéristiques du film au même niveau, qui leur donnerait la même importance. Que ce soit le son, la parole, l’image, le décor… Je n’ai pas toujours de réponse très claire à ce sujet mais c’est quelque chose qui m’a toujours intéressé et que j’essaie de pousser un peu plus loin à chaque film en questionnant mes méthodes de travail.
C. P. Je me suis demandé plusieurs fois dans quelle ville se déroulait ton film, si c’était bien Bruxelles ou non. C’est là que tu vis?
B. D. Oui.
C. P. Donc tu filmes des lieux que tu connais et dans lesquels tes personnages habitent, mais ils n’y sont pas ancrés de la même manière.
B. D. Cette question d’ancrage est pertinente à Bruxelles. C’est une ville qui existe grâce aux minorités, une ville très diverse où tout le monde semble venir d’ailleurs. Comme si personne n’était né là-bas et que tout le monde y venait pour trouver une vie. Même moi qui n’y suis pas né, je vis là-bas depuis plus de vingt ans et je commence à peine à comprendre que Bruxelles m’appartient et que j’appartiens à Bruxelles. Cette question est vraiment présente dans chaque conversation. La première question quand on aborde quelqu’un dans la rue c’est de savoir si on parle la même langue et souvent la réponse est non. Il faut alors trouver une autre manière de communiquer. Même si on trouve une langue commune il y a cette deuxième question qui est : « Qu’est-ce qui vous a amené ici ? ». C’est super intéressant je trouve. Toi, qu’est-ce qui t’a amené vers le décor de ton film, Dans la tête un orage ?
C. P. J’ai rencontré cet endroit il y a quelques années un peu par hasard en allant visiter des proches. C’est un ancien quartier ouvrier fait de tours HLM avec des zones naturelles et des terrains vagues autour. Quelques temps auparavant j’étais dans la banlieue de Rouen, là où ma famille paternelle a vécu, dans un quartier assez similaire et qui venait d’être détruit. Quand j’ai traversé cet endroit en banlieue de Calais, j’ai eu la sensation qu’il résonnait avec mon histoire familiale. Il y a eu quelque chose de l’ordre du fantomatique qui s’est présenté à moi. C’est comme ça que j’ai eu le désir de m’investir dans ce lieu. Quand je m’y suis arrêté, des enfants et des adolescents sont venus me parler, puis j’y suis retourné tout l’été. Dans mon travail j’ai l’impression que je m’ancre toujours dans un lieu avant tout et que ce sont les lieux qui font germer en moi le désir de faire un film. Les lieux puis les gens qui s’y inscrivent. Ce sont toujours des lieux en périphérie et qui sont comme traversés par une histoire, celle des marges, des classes populaires. En tout cas des lieux qui en portent quelque chose dans leur géographie, leur architecture, leur histoire et qui s’imposent à moi. Les lieux ont leur vie propre. Ce que tu disais sur Bruxelles, ce côté multiculturel, morcelé, j’ai l’impression qu’on le retrouve dans l’architecture à Bruxelles. Un côté « de bric et de broc », de choses qui cohabitent malgré leurs différences. La différence je pense dans mon film, c’est que mes personnages s’ancrent dans le lieu depuis des générations. C’est un endroit assez homogène.
B. D. J’ai ressenti dans ton film une force de gravité. Il y a quelque chose de l’ordre du déterminisme dans leurs corps aussi. On est ici, on reste ici. J’ai vu ça aussi à Bruxelles dans certains quartiers, certaines cités où j‘ai filmé. Je ne veux pas dire que c’est un manque d’espoir mais il y a une sorte de conscience sociale et politique dans les corps. C’est peut-être moi qui projette ça sur eux je ne sais pas.
C. P. C’est très ambivalent. C’est vrai que c’est un lieu dont ils ne sortent pas. Leurs corps sont marqués socialement, ils grandissent et sont donc appelés à devenir quelque chose qui les dépasse. Mais ce qui m’intéressait dans ce lieu et mon rapport à ces personnes c’est d’interroger cela sans les condamner à une situation sociale ou à un destin. Il s’agissait de trouver de la douceur, de la tendresse, de la beauté… C’est ça aussi l’enfance. Même si tout est très marqué, filmer des enfants c’est aussi filmer des possibilités et donc une forme d’espoir. Il y a aussi une grande part de rêverie dans les visages, ce qui permet de trouver des bulles d’échappatoires.
B. D. Par le jeu.
C. P. Oui exactement. Tu vois par exemple ce petit garçon qui plume un oiseau ? Il reproduit des gestes qu’on lui a appris mais qui sont aussi une manière de réinventer un rapport à un territoire. Pêcher, chasser, jouer, s’isoler… Ce sont des façons de trouver de la liberté. J’espère qu’ainsi je ne les condamne pas.
B. D. Non pas du tout. Quand j’ai fait Hellhole, mon deuxième film qui parle de Bruxelles après les attentats de 2016, je filmais à la Cité Modèle à Bruxelles, un quartier très complexe et très intéressant. J’ai vraiment dû me battre avec cette question. Et là on entre aussi peut-être dans cette question de frontière poreuse ou transparente entre la fiction et le documentaire. Comment montrer cette gravité qui est tangible, qui est dans leur corps, sans les résumer à ça ? J’ai trouvé ça extrêmement difficile. Je ne sais toujours pas si cette partie du film est réussie.
C. P. Comment tu abordes ça ? Dans mon film la manière la plus juste que j’ai trouvé pour aborder ça, c’est par le geste de fiction. Même si mon film est documentaire, tout ce qu’on voit sont des scènes qui sont jouées et rejouées. J’ai invité ces enfants et adolescents à se transformer en personnages. Je n’ai pas voulu faire du cinéma direct mais plutôt les inviter à jouer. Pour eux c’était aussi une manière de ne pas subir le dispositif, qui aurait pu leur voler quelque chose. Ce rapport à la fiction permet de s’extraire des choses et de les transfigurer.
B. D. Le jeu, je l’ai vécu dans le cinéma avec des jeunes entre 16 et 20 ans qui étaient vraiment à un moment charnière dans leur vie. Certains se sont échappés, d’autres sont restés et ont vécu des histoires très dures. Ils n’avaient pas fini l’école et me disaient déjà que leur vie était foutue. Ça m’a beaucoup marqué. Chez les enfants il y a encore une imagination qui est forte, qui est vivante. Ils sont capables de s’imaginer ailleurs. Ce qui me choquait le plus c’était cette absence d’imagination, cette impossibilité à se voir dans un autre endroit, à vivre différemment, à être heureux. J’ai trouvé ton rapport à tes personnages très touchant dans ton film. Il y a une petite narration, celle de la jeune fille blonde. Tu sentais que tu avais besoin de quelque chose pour tenir le film ?
C. P. À l’origine j’avais envie de faire le portrait d’un lieu et pas d’une personne en particulier. J’ai rencontré Kyllianna, cette jeune fille très mutique et secrète. Mais elle était là et elle avait envie de donner quelque chose d’elle. On a inventé ensemble ce parcours, ce geste de fiction qui passe aussi par la déambulation et le mouvement, et qui rompt avec l’aspect statique du lieu et donc du film. Elle nous fait traverser ces espaces parce qu’elle quitte ce quartier pour aller dans la nature.
B. D. C’est le premier moment où la caméra bouge.
C. P. Oui, elle crée du mouvement. Ça nous permet de traverser les espaces de manière organique. Ce qu’on retrouve aussi dans ton film, cette déambulation. Une scène dans ton film m’a frappé. Le plan où il rentre dans les bois en écartant une grille. Il franchit des frontières. C’est un peu comme un guide.
B. D. C’est une très belle image, le guide qui ne sait pas qu’il en est un.
C. P. C’est presque magique comme image. Tu crées une porte vers d’autres mondes, vers d’autres personnes. Plusieurs fois dans le film il y a des tentatives de connexions, on sent qu’il y a des trajectoires qui coexistent, même dans le bus quand il effleure une femme. Ce sont des individus qui créent du lien sans se connaître ou se comprendre. Il y a un vrai soin dans l’infime qui permet de voir autre chose que la violence. C’est aussi quelque chose que j’ai essayé de faire : voir l’à côté. La violence dans le son et le hors-champ mais la douceur dans les visages. Dans ton film aussi la ville peut être écrasante.
B. D. Oui j’essaie toujours de penser à des moments de tendresse que j’observe alors qu’on est conditionnés à ne pas les voir. C’est ce qui m’intrigue au cinéma. Il y a des modes de narrations qui ne m’intéressent pas trop. Surtout dans la fiction. Le monde du documentaire ou du cinéma hybride, c’est un peu différent. Moi j’ai toujours évolué à la frontière, mais quand même dans la fiction et le cinéma narratif. Je me sens parfois un peu seul en Belgique. Je cherche toujours des choses qui ont de la valeur mais qui ne sont pas reconnues comme telles ou pas suffisamment. Je me pose toujours la question de savoir quelles sont les choses qui ont de la valeur. La réponse n’est pas spectaculaire, mais je crois qu’on a besoin de ne pas comprendre, qu’on a besoin de mystère, d’une véritable altérité. Pour moi, faire du cinéma c’est un peu essayer de formuler quelque chose qui est difficile à dire.
C. P. Que l’on puise dans une matière invisible, dans la lumière, dans le son…
B. D. Mais ça m’étonne toujours de voir que les films qui essaient de faire des choses différentes sont assez rares. La plupart des films essaient de m’expliquer comment le monde est. Il manque la possibilité d’imaginer comment le monde aurait pu être ou devrait être.
C. P. Comment tu travailles la narration ? Tu écris beaucoup ? Tu y prends du plaisir ? Tu trouves d’autres manières de travailler ?
B. D. Pour moi ce sont deux choses séparées. J’écris beaucoup mais c’est aussi fortement lié aux manières de financer les films. En Belgique il y a un intérêt pour le scénario, la bonne histoire. Au début je trouvais ça ennuyeux et fatigant. Puis je me suis mis à apprécier le travail de l’écriture. J’apprécie cette démarche de traduction de la pensée aux mots. Mais pour moi le scénario n’est pas lié au tournage, il n’est jamais présent sur le plateau. C’est différent aussi quand on fait un long-métrage. Sur un court, tu peux te sentir comme le maître de tes propres idées. Quand je fais un long je dois accepter de lâcher, de ne pas savoir si une scène va fonctionner avec celle qui la précède et celle qui la suit. Je n’ai pas le film entier en tête. Je suis dans le moment, dans le présent de la scène qu’on est en train de tourner, au risque de ne pas faire les choix qu’il faudrait par rapport à ce qui l’entourera au montage. L’écriture pour moi c’est important pour faire exister cet équilibre entre des idées abstraites et des émotions concrètes.
C. P. Tu produis des images en-dehors des tournages ?
B. D. Non jamais, j’évite ça. Avec Grimm Vandekerckhove mon chef opérateur, on a jamais des références d'autres films ou de photographes. C’est un effort un peu inutile parce qu’on a tous emmagasinés tellement d’images qu’on est déjà si conditionnés. Pour moi le vrai travail c’est d’être informé par le scénario, par nos conversations, par les corps des comédiens, par le lieu… Tout ce qu’on peut faire au tournage c’est d’oublier tout et essayer d’être là.
C. P. Moi je travaille beaucoup avec le son, j’enregistre beaucoup.
B. D. Pendant la préparation ?
C. P. Oui pendant l’écriture. J’ai peu écrit, en tout cas pas de scénario en tant que tel. J’ai beaucoup travaillé avec de la matière sonore. De manière générale j’enregistre beaucoup de sons.
B. D. De manière à pouvoir les utiliser ensuite ?
C. P. Pas forcément. Des fois c’est avec mon téléphone. J’enregistre les fréquences d’un lieu. Souvent quand je vais quitter un endroit que j’aime par exemple. Il peut m’arriver de faire des vidéos, mais par fragments, de capter la respiration d’un lieu, par sa lumière par exemple.
B. D. Je fais ça aussi. Hier j’ai enregistré l’orage ici dans l’hôtel. Une femme était au téléphone, des F16 passaient, c’était très bizarre. C’est comme s'ils créaient le tonnerre, tout était mélangé. Pour moi le son est beaucoup plus important pour sentir et comprendre mes films. Parce que les images sont concrètes. C’est ce qui est là. Le son c’est tout ce monde que je ne peux pas matérialiser. Quand je faisais mon deuxième film j’ai enregistré beaucoup de lieux. Maintenant après trois films à Bruxelles, autour de Bruxelles, même sur Bruxelles, j’en ai un peu marre des sons de Bruxelles. C’est un peu comme quand on n’est plus attentif aux lieux qu’on connaît bien. Je n’entends plus trop cette ville. J’ai travaillé avec un ingénieur du son qui s’appelle Chris Watson. C’est un peu une superstar dans ce milieu. Il a commencé sa carrière comme ingénieur du son sur des documentaires de David Attenborough où il a fait des choses très bizarres pour enregistrer des sons très proches d’animaux. Il cachait des micros dans de la viande par exemple pour enregistrer des lions. Il a aussi évolué dans le monde de la musique avant-gardiste. Il est venu à Bruxelles pour moi un jour pour enregistrer Bruxelles. Il disait : « Moi j’entends les sons de Bruxelles, toi tu ne peux plus les entendre ». Il m’a donné des heures et des heures d’enregistrements de ma propre ville. Il a capté des détails que j’utilise encore dans mes films.
C. P. Tu penses qu’on n’entend plus et qu’on ne voit plus par usure ?
B. D. Oui par habitude. On perd peu à peu la précision d’un endroit. C’est pour ça que c’est intéressant aussi que tu aies filmé un endroit qui est en toi sans que tu y habites. Je sens aujourd’hui que je voudrais faire un film qui quitte Bruxelles.
Entretien réalisé à Paris le 10/07/2024.
Portrait de la page d'accueil : Nina Linnemann
Après son diplôme, Bas Devos a réalisé deux courts métrages, The Close et We Know. Son premier long métrage, Violet, a remporté le Prix du Jury à la Berlinale Generations 2014 et a été sélectionné pour New Directors New Films au Moma. Son deuxième long-métrage a été sélectionné au Panorama de la Berlinale 2019. Ghost Tropic, son troisième film, à été selectionné à la Quinzaine des réalisateurs en 2019. Son quatrième film, Here, a été programmé luo à la Berlinale dans la section Encounters et présenté au FIDMaseille.
︎︎︎ Bas Devos
Clément Pérot est artiste et réalisateur, diplômé de l’Ensad puis des Beaux-Arts de Paris en 2022. À travers des formes hybrides dialoguant entre image, écriture littéraire et installation filmique, sa pratique s’inscrit dans des lieux en marge de notre société et marqués par l’histoire des classes populaires et ouvrières. Dans la tête un orage est son premier film documentaire. Il développe actuellement l’écriture d’un film de fiction.
︎︎︎ Clement Pérot