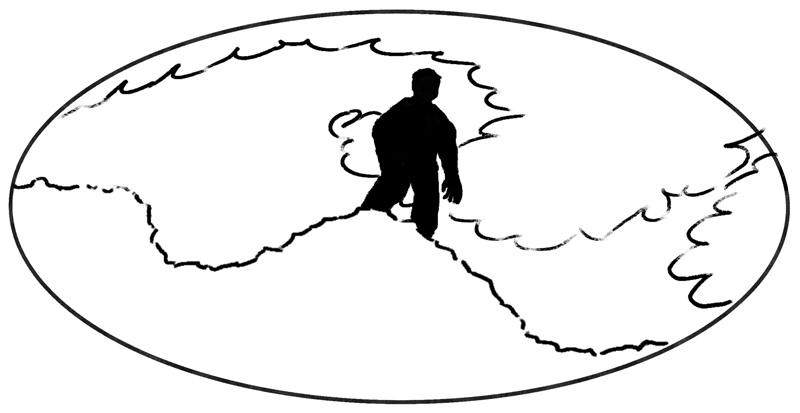Étreindre les images
Alice Rohrwacher et Pauline Hisbacq

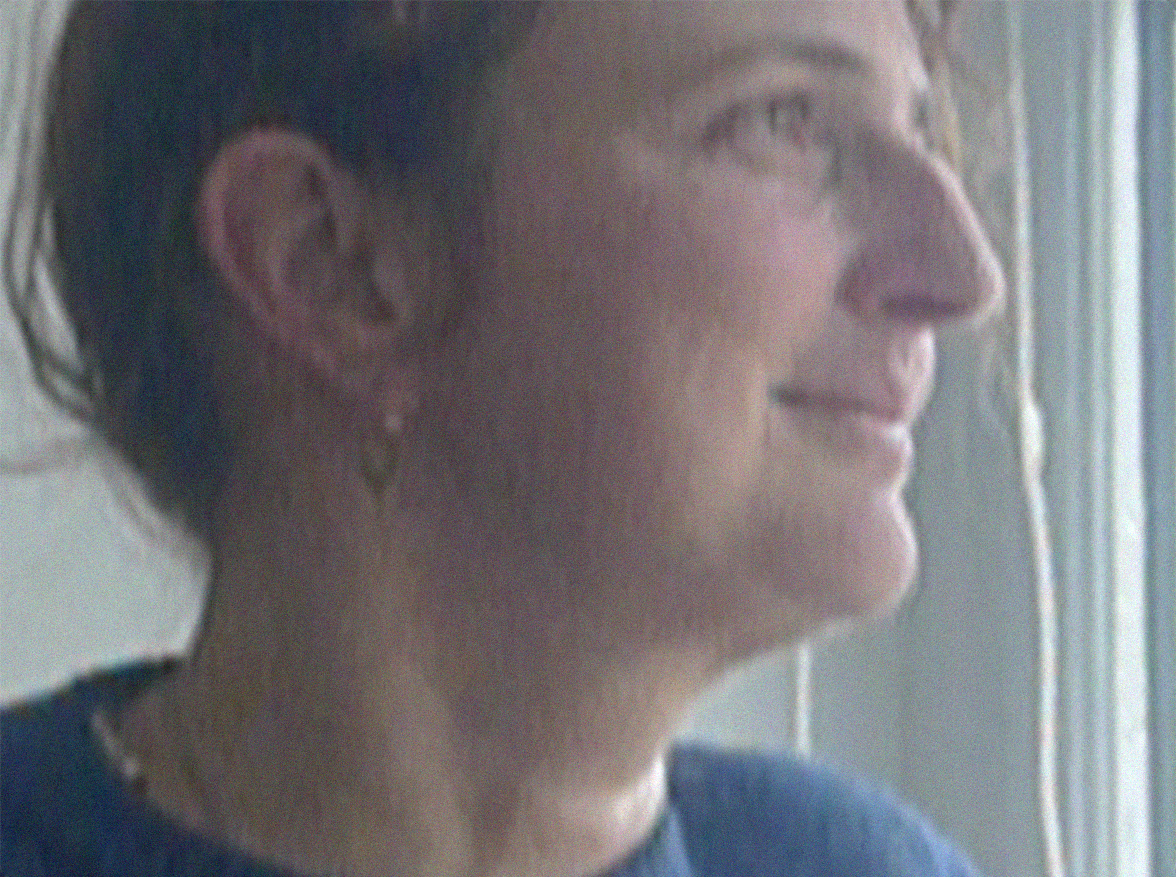
Pauline Hisbacq Quand je commence à travailler sur un projet je m’accompagne toujours d’essais et de films. Je me demandais quels étaient vos compagnons à vous dans ces moments.
Alice Rohrwacher Pour moi ce sont toujours les gens avec qui je travaille et avec lesquels je cherche à poursuivre une collaboration. Construire un discours ce n’est pas seulement un travail solitaire, c’est aussi une chose familiale. Cette famille de cinéma qui s’est créée depuis mon premier film avec Hélène Louvart, Loredana Buscemi, Chiara Polizzi, Tiziana Poli, Nelly Quettier et tant d’autres, c’est ce qui me motive. L’idée de travailler avec eux m’inspire déjà beaucoup !
Lucas Charrier Et pendant l’écriture avec qui parlez-vous de vos films ?
A. R. Pendant l’écriture je suis toujours en relation avec ma soeur Alba ou avec Carmela Covino. Ce sont des oreilles attentives, auxquelles je peux raconter des histoires. On se base beaucoup sur l’oralité. Mais l’écriture est une partie assez solitaire malgré tout.
L. C. Quel est votre rapport aux références, aux films qui pourraient éventuellement vous aider à trouver une direction, à identifier l’identité visuelle ou la tonalité d’un projet ?
A. R. Je pense que, quand j’ai des références, ça ne vient pas de l’histoire du cinéma. J’arrive à cette histoire, mais en passant par la réalité. Prenez par exemple la scène de découverte du tombeau où les fresques disparaissent au contact de l’air dans La Chimère. Naturellement je connais le merveilleux film de Fellini Roma, mais je n’aurais jamais pensé à le citer. Tout le monde raconte ce moment où, en entrant dans un tombeau, les fresques perdent leur éclat. J’étais obligée de filmer ça. J’ai donc cité Fellini, mais en passant par le réel. Ce n’est pas une référence théorique. Ce qu’il y a de merveilleux avec le cinéma c’est qu’on tombe dans sa mémoire par hasard.
L. C. C’est aussi ce qui est beau dans votre cinéma, cette liberté. On sent que vous n’êtes pas écrasée par le poids du cinéma. On sent que vous vous amusez beaucoup. En revoyant récemment La Leçon de Piano, le premier plan m’a rappelé celui de La Chimère, en vue subjective avec des mains devant l’objectif. Ce n’est donc sans doute pas une référence consciente mais le lien entre La Leçon de Piano et La Chimère est très beau parce que c’est peut-être votre film qui a le plus à voir avec le mélodrame.
A. R. Oui c’est magnifique La Leçon de Piano.
P. H. Dans Heureux comme Lazzaro, quand on le voit gravir la colline, je pense toujours à Où est la maison de mon amie ? d’Abbas Kiarostami.
A. R. C’est simplement parce qu’on s’est retrouvés dans un lieu qui faisait que Lazzaro devait accéder à son refuge de cette façon.
Le cinéma que j’aime c’est celui qui fait partie d’une mémoire collective. On peut se rappeler ensemble de choses qu’on partage dans et par le cinéma.
P. H. Oui les images circulent.
A. R. Mais je pense que c’est toujours le hasard de la réalité qui inspire cet amour pour les cinéastes.
L. C. Comment vous situez-vous dans le cinéma contemporain, entre des cinéastes qui font comme vous partie d’un circuit de distribution international en salles, et d’autres qui appartiennent plus au monde de l’art comme Ben Rivers ?
A. R. J’aime beaucoup Ben Rivers. J’ai mes relations aux films des autres, mais pas tellement comme réalisatrice. Leurs films me parlent comme à une spectatrice, comme une partie du public prête à recevoir de la poésie. Souvent, quand on prépare un film, il y a toujours quelqu’un de la distribution ou de la production pour me dire que mon projet n’a pas de public. En tant que spectatrice faisant donc partie du public, je peux aussi dire qu’il y a un public qui n’a pas de films, qui voudrait plus de films qui inspirent la liberté et la poésie, qui veut voir par la petite porte de la réalité quelque chose de plus grand qui nous unit.
L. C. Quand vous faites Quattro Strade, c’est proche de ce que peut faire Ben Rivers dans le sens où vous avez un rapport artisanal et très direct à la fabrication. Vous faites vous-même vos images, vous portez la caméra, vous filmez en pellicule, vous êtes seule avec vos personnages. C’est assez rare dans le circuit du cinéma qui est le vôtre de trouver des cinéastes qui font leurs propres images. Pourriez-vous imaginer tout un long-métrage que vous filmeriez seule ?
A. R. Vous connaissez le dicton : « Deux corps, une âme » ? J’ai eu la chance immense de rencontrer Hélène Louvart. Quattro Strade n’était pas un projet très élaboré et pensé à l’avance, je voulais simplement voir si la pellicule n’était pas périmée. C’était des restes du tournage de Corpo Celeste, des bobines 16mm que j’avais gardées dans le frigo depuis 2010. J’aime beaucoup ces images mais j’aime encore plus quand je les fais avec quelqu’un, je crois. Au fond je pense que ça ne change pas grand chose. Qu’on soit seul ou en groupe, on peut toujours trouver le moyen de donner du caractère aux images, de faire en sorte que les images soient un personnage du film.
L. C. Votre goût pour la pellicule vient aussi de l’absence de contrôle que cette technique implique. C’est aussi ton cas Pauline ?
P. H. Oui complètement, j’aime oublier l’image et la rencontrer une fois qu’elle est développée.
L. C. Ce temps d’attente avant la découverte de l’image est important non ?
P. H. Oui c’est un temps nécessaire. Et je ne suis pas très technicienne donc il y a toujours un peu la surprise de voir comment le flash a réagi, de savoir si l’image est correctement exposée…
A. R. Il y a une distance nécessaire aujourd’hui. On ne se donne jamais le temps de penser avant de produire une image. En numérique on est toujours prêts. La pellicule nous impose un temps pour les images. Souvent, sur un tournage, il y a toujours quelqu’un qui demande un moment pour les raccords maquillage, ou pour les costumes, le décor… Et pourquoi pas un temps pour les images ? En pellicule, on est obligés de prendre du temps pour les images. C’est quoi ce temps ? C’est le temps de les faire, de les digérer et de les voir avec une distance. Quand elles arrivent il s’est déjà passé, deux, trois, quatre jours… Alors, on se confronte avec une archive.
L. C. Venons-en à La Chimère. Tous vos films avant précédents commencent de nuit, mais pas celui-ci. Il s’ouvre par une image éclatante qui contraste avec le reste du film, beaucoup moins lumineux. Cette première image c’est le vrai trésor du film, celui qu’Arthur recherche à tous prix. C’est un visage qui se cache et s’amuse, qui nous regarde et nous sourit, mais un visage qu’on à le temps de reconnaître, celui d’une enfant (celle de Corpo Celeste) devenue adulte. C’est aussi votre film qui joue le moins avec la lumière et qui a le moins à voir avec l’enfance. Mais c’est pourtant un film très joueur visuellement. Et c’est aussi le premier visage de toute une série de visages d’enfants qu’on a croisés dans vos films précédents. Il se passe donc énormément de choses dans ce premier plan. Pouvez-vous nous en parler ?
A. R. Le film commence dans une obscurité mécanique, l’objectif est couvert et quelque chose doit être enlevé. Je voulais tout de suite donner cette image de l’ouverture. Le film raconte l’historie de quelqu’un qui cherche la porte de l’au-delà, et c’est une porte vers une lumière. C’était très important de raconter ce que recherche Arthur. Ce n’est pas un personnage qui cherche la nuit, la douleur, l’obscurité. Il cherche la lumière, son étoile, son soleil. Elle lui dit tout de suite : « Est-ce que tu as vu que le soleil nous suit ? ». Je voulais lier Arthur à cette idée que le soleil qui le suit, c’est Beniamina. La lumière qui le touche, c’est elle. Elle est dans la lumière, pas dans le royaume des ombres. Quand on parle de l’au-delà, on a toujours l’image d’un lieu obscur. Je voulais que ce soit un endroit de solitude mais plein de lumière. Elle est confinée dans la lumière.
P. H. Je trouve que les visages que vous filmez sont très intenses et tendres. Ce sont toujours des visages que j’ai envie de photographier. Je pense à Lazzaro mais aussi aux jeunes filles dans le train au début de La Chimère. Qu’est-ce que vous cherchez dans ces visages, comment vous choisissez vos modèles ? On est pas dans les canons de beauté habituels.
A. R. Je pense que le visage c’est un cadeau que l’autre nous offre. Comme le raconte Levinas, le visage c’est la porte vers l’autre. Si je pense aux Étrusques, ils n’ont pas laissé d’histoire écrite, mais des images et des visages qu’ils ont dessinés et qui nous offrent une porte d’entrée dans cette culture. C’est pour ça que je voulais entrer dans le film avec un visage. Il y a celui de Beniamina, d’Arthur, ceux des filles dans le train qui regardent Arthur et qui sont heureuses parce qu’Arthur est beau. Cette idée qu’on peut être heureuse en voyant quelqu’un de beau, que la beauté puisse nous rendre heureux, c’est incroyable. La manière dont commence le premier dialogue entre ces filles et Arthur est lié au visage. Il voit une histoire plus ancienne dans les visage de ces filles, des racines. Elles, elles voient du mystère, l’inconnu. Je voulais commencer le film par un voyage dans le merveilleux du visage.
L. C. Vous avez l’impression que quand vous faites un casting votre intérêt pour un acteur ou une actrice passe beaucoup par le visage ?
A. R. Le visage, le corps… Naturellement, le visage c’est important. Dans certains je vois une porte, dans d’autres je reste à l’extérieur. La chose la plus incroyable, surtout dans une époque où on a plus l’obsession de la perfection, c’est les défauts. C’est ça la clé, c’est ça qui ouvre une porte. Ce n’est jamais la perfection. Ce sont des visages très réels et en même temps très mythologiques. Ils sont dans la réalité. Et dans la réalité je cherche toujours les traces de quelque chose. Quand on tombe amoureux, on tombe amoureux d’un souvenir.
P. H. On reconnaît quelque chose.
A. R. Oui on reconnaît quelque chose dans l’autre. Même si ce n’est pas quelque chose que l’on connaît. Quelque chose arrête notre regard parce que nos yeux trouvent dans cette personne quelque chose qu’on reconnaît, même si on ne l’a jamais vécu. On peut tomber amoureux de choses très loin de nous, mais il y a toujours un sentiment de familiarité. Je pense que tous les corps et les visages qui sont dans mes films me rappellent quelque chose.
P. H. Ce que j’aime beaucoup dans votre façon de filmer ce sont vos cadres très remplis, votre façon de les fermer, de les contenir, par des personnages, des lieux… C’est ce que je fais aussi dans mes images. Je recadre. C’est une façon de resserrer, comme si j’étreignais mon image.
A. R. Oui je pense qu’il faut avoir confiance dans l’image comme un lieu de rassemblement.
L. C. On le voit dans Futura, où on peut observer dans vos segments votre distance à vous. Vous êtes moins proche des visages, vous remplissez le cadre avec plus de personnages.
A. R. J’aime regrouper les visages et les mettre en relation avec les autres, ne pas trop les isoler. C’est vrai que dans Futura j’ai privilégié les groupes plus que des individus.
P. H. Cette question du groupe est essentielle dans votre cinéma. J’ai été très frappée par l’ouverture des Merveilles, avec les enfants qui dorment tous ensemble. Comme si c’était des tas d’enfants. Tous ces corps n’en forment plus qu’un seul. Ce qui nous amène aussi à l’enfance dans votre cinéma, qui est aussi ce qui me touche particulièrement dans vos films.
A. R. L’enfance c’est un regard privilégié qu’on a tous eu dans la vie, plus ou moins longtemps. Un regard de confiance dans l’autre, dans le monde. On était prêts à changer de point de vue sur le monde. Les enfants aiment assembler des choses très différentes : le sérieux et le jeu, le réel et l’irréel, le visible et l’invisible, la réalité et l’imagination… Ils ne pensent pas que ce sont des élément séparés, qui ne dialoguent pas entre eux. Ces mondes se nourrissent les uns les autres. C’est évident mais on a tendance à l’oublier. C’est peut-être pour ça que j’aime beaucoup filmer les enfants mais aussi les enfants dans l’âme, pas seulement ceux qui ont l’âge de l’être. Lazzaro, même s’il est adulte, est aussi un éternel enfant. Il y a dans l’enfance cette possibilité d’être ouvert et de voir dans les frontières pas seulement des divisions, mais aussi des lieux de rencontre.
P. H. Dans La Chimère il y a ce lieu, cette ancienne gare investie par un groupe de femmes et d’enfants, Riparbella. C’est une très belle scène, on aurait presque envie d’en voir plus. Comment est naît cette idée ?
A. R. C’est l’espoir du film. J’ai toujours envie de finir un film par une histoire qui commence. Là c’était une belle idée à ramener à la maison. Tout le film évolue autour d’un message important, qui est encore la relation homme-femme, un débat qu’on pensait révolu. Je suis fille d’un père féministe alors je pensais que c’était réglé. En grandissant j’ai compris que ce n’était pas du tout le cas. Au contraire, c’est encore très présent et violent. Avec la bande des Tombarolli, je voulais donner une image différente du machisme. Ce sont tous des machistes, mais ce sont des machistes pauvres. Il y a une misère, une solitude, une tristesse dans ce machisme. C’est comme une prison pour eux. Ils n’ont pas eu la possibilité de réfléchir à leur condition d’homme, ils acceptent les codes du passé, selon lesquels un homme doit être vulgaire, doit conquérir les femmes étrangères, et être méchant avec son épouse. Ce sont des codes stéréotypés et très archaïques. Il y avait chez les Étrusques une grande parité entre les hommes et les femmes. Je voulais aussi créer une autre vision des femmes et raconter que l’héritage du passé n’est pas seulement quelque chose qu’on doit détruire ou cristalliser, mais qu’on peut aussi le transformer. Qu’est-ce que ces femmes sont capables de faire ? Prendre un espace abandonné et le transformer en autre chose. C’est un petit espoir dans un film sans espoir.
P. H. J’ai beaucoup photographié la statuaire à Naples. Les entrailles de la terre avec Pompéi. Et j’ai mis des années à m’approprier ces images. Je les photographiais comme des fantômes. Ça a pris sens quand j’ai assumé de relier ces images à celles de ma fille. Ça parle de l’intime et du très grand, de ce qui se passe entre les corps qui sont morts et ce corps qui vient de naître. Est-ce que vos films prennent parfois racine dans une raison intime ?
A. R. Je partage cette même sensation, ce même besoin de créer des liens entre l’intime et le collectif, la vie personnelle et le monde. Comme des zooms avant et arrière pour nous permettre de suivre une histoire, mais de la cadrer dans un environnement un peu plus grand. C’est ce que je recherche, pour une raison politique aussi. Je pense qu’on doit briser l’hypnose collective de l’individualisme. Comment faire ? Par un changement de perspective sur la réalité. C’est pour ça que mes films partent toujours de la réalité. Même l’histoire des pilleurs de tombes des années 80 est très liée à l’histoire d’aujourd’hui, à un changement de regard nécessaire sur notre passé, sur ce qui est sacré, ce que veut dire profaner dans un monde déjà profané. Je pars toujours d’histoires très intimes mais d’un autre côté il y a une grande histoire, le bouleversement d’une époque. Dans La Chimère c’est le triomphe du matérialisme. Comment raconter ça ? Il n’y a pas mieux que de raconter l’histoire de quelqu’un capable de faire du profit à partir d’objets ayant appartenu à des morts pour raconter le matérialisme. C’est le tabou ultime. Voler ces objets.
P. H. Et les casser…
A. R. Oui. Et les vendre. Les objets ne sont là que pour être vendus, il n’y a rien de sacré pour eux. Si on peut faire ça avec les objets des morts on peut aussi le faire avec les corps des gens, avec la nature, avec tout. C’est seulement pour dire que les racines intimesse mêlent à un réseau de racines beaucoup plus grand, plus large. C’est le cliché qui dit que quand on parle de racines, on parle de nous-mêmes. L’artiste cherche sa propre histoire dans les racines. Il faut toujours avoir en tête l’image de l’arbre dans la forêt dont les racines sont toutes rattachées entre elles. S’intéresser aux racines revient donc à sortir de soi-même.
L. C. Il y a toujours dans vos films, et dans La Chimère particulièrement, un rapport au sacré, à l’invisible, à ce qui se dérobe, ce qui échappe au regard et ne peut être montré. Est-ce qu’il y a parfois des choses que vous n’arrivez pas à filmer, des images sur lesquelles vous butez ?
A. R. Ça me fait penser que dans notre travail, dans la vie de tous les jours, il y a quand même une partie de notre travail qui n’est pas fait pour être montrée. Pour les Étrusques c’était pour les âmes des morts. Ce n’est pas une histoire de secrets. Quand je pense aux Étrusques je pense à la somme de travail que représentait la fabrication des objets, surtout à l’époque. L’argile, les couleurs, la cuisson… Tout ça, pendant des mois, pour finalement tout cacher. C’est un symbole très fort de travailler pour l’invisible. On est maintenant dans une époque qui a l’obsession de la visibilité. Il y a eu aussi des moments pendant mes tournages où j’ai senti que je ne pouvais pas filmer certaines choses. Il y a parfois des choses tellement belles, que tu peux accepter dans l’image seulement si elles sont centrales, si elles sont le sujet de l’image. Ce serait injuste de les laisser à l’arrière-plan.
P. H. Vous pensez à quoi par exemple ?
A. R. Quand j’ai tourné Les Merveilles, on devait filmer une scène où Gelsomina cherche les abeilles dans les arbres. On avait décidé d’amener les abeilles dans un olivier devant une église abandonnée. Un lieu magique auquel je suis très attachée. Quand je suis arrivée là, j’ai vraiment vu que je ne pouvais pas filmer l’église simplement comme un détail dans le fond de l’image. C’était un lieu tellement important. On a inversé le plan et j’ai filmé le contre-champ. Il y avait des gens dans l’équipe qui ne comprenaient pas pourquoi. On retrouve ce lieu maintenant dans les scènes de Beniamina. J’avais un désir fort de filmer ce lieu mais il devait être au coeur de l’image, il devait avoir un sens. Il y a des belles images qu’on doit utiliser avec beaucoup d’attention. On doit laisser l’espace à la beauté, on ne peut pas simplement en profiter.
Entretien réalisé à Paris le 4 Décembre 2023 par Pauline Hisbacq et Lucas Charrier.
Remerciements : Viviana Andriani et Marie Queysanne.
“Alice Rohrwacher - Le Vrai du faux”, entretiens avec Eva Markovits et Judith Revault d'Allonnes, publié aux Éditions de l'Oeil à l’occasion de la retrospective “Alice Rohrwacher, Rêver entre les mondes”, présentée du 1er décembre 2023 au 1er janvier 2024 au Centre Pompidou.
Alice Rohrwacher est une réalisatrice italienne née le 29 décembre 19802 à Fiesole. Son premier film de fiction, Corpo Celeste est présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 2011. Son deuxième film Les Merveilles reçoit le Grand Prix au Festival de Cannes en 2014. Heureux comme Lazzaro reçoit lui le prix du scénario en 2018. Elle est nommée à l’Oscar du meilleur court-métrage de fiction en 2023 pour Le Pupille. Elle revient de nouveau à Cannes en 2023 en compétition avec La Chimère.
︎︎︎ filmographie
Pauline Hisbacq est une photographe française née en 1980 et diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles. Son travail, en photographie ou par la manipulation d’images d’archives (collages, montage), évoque de manière poétique les questions de la jeunesse, du désir, des rites de passage et de résistance. Elle cherche les sentiments dans les formes et les figures. Elle explore aujourd’hui ce qui lie l’intime et le politique, le mythe et le contemporain. Son travail a été présenté entre autres au Salon de Montrouge (2011) et au Bal (2019). Elle a co-fondé la maison d’édition September Books avec François Santerre en 2016. En 2017, elle a obtenu la bourse Soutien à la photographie documentaire contemporaine du CNAP pour le projet La fête et les cendres. En 2021, elle a bénéficié de l’Aide Individuelle à la Création de la DRAC Ile de France pour le projet Rimorso. La même année, elle a été lauréate de la commande nationale Regards du Grand Paris mené par le CNAP et Les Ateliers Médicis avec le projet Pastorale. En 2023, sa série La fête et les cendres est montrée à La plateforme de Dunkerque et au FRAC Grand Large dans le cadre de la biennale Chaleur humaine, et au Centre Tchèque de Paris dans le cadre de Photo Saint Germain.
︎︎︎www.paulinehisbacq.com
Alice Rohrwacher est une réalisatrice italienne née le 29 décembre 19802 à Fiesole. Son premier film de fiction, Corpo Celeste est présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 2011. Son deuxième film Les Merveilles reçoit le Grand Prix au Festival de Cannes en 2014. Heureux comme Lazzaro reçoit lui le prix du scénario en 2018. Elle est nommée à l’Oscar du meilleur court-métrage de fiction en 2023 pour Le Pupille. Elle revient de nouveau à Cannes en 2023 en compétition avec La Chimère.
︎︎︎ filmographie
Pauline Hisbacq est une photographe française née en 1980 et diplômée de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles. Son travail, en photographie ou par la manipulation d’images d’archives (collages, montage), évoque de manière poétique les questions de la jeunesse, du désir, des rites de passage et de résistance. Elle cherche les sentiments dans les formes et les figures. Elle explore aujourd’hui ce qui lie l’intime et le politique, le mythe et le contemporain. Son travail a été présenté entre autres au Salon de Montrouge (2011) et au Bal (2019). Elle a co-fondé la maison d’édition September Books avec François Santerre en 2016. En 2017, elle a obtenu la bourse Soutien à la photographie documentaire contemporaine du CNAP pour le projet La fête et les cendres. En 2021, elle a bénéficié de l’Aide Individuelle à la Création de la DRAC Ile de France pour le projet Rimorso. La même année, elle a été lauréate de la commande nationale Regards du Grand Paris mené par le CNAP et Les Ateliers Médicis avec le projet Pastorale. En 2023, sa série La fête et les cendres est montrée à La plateforme de Dunkerque et au FRAC Grand Large dans le cadre de la biennale Chaleur humaine, et au Centre Tchèque de Paris dans le cadre de Photo Saint Germain.
︎︎︎www.paulinehisbacq.com